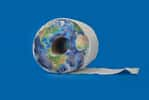au sommaire
La garriguegarrigue désigne une formation végétale constituée d'arbrisseaux épineux résistant à la sécheressesécheresse. Cette formation est la conséquence de la dégradation de la forêt de chênes verts et blancs qui passe à des pins d'Aleppins d'Alep, puis à la garrigue par le mouton, l'Homme, le feu et ce, depuis le réchauffement climatiqueréchauffement climatique postglaciaire.

Cette évolution est caractéristique des régions méditerranéennes. La garrigue se trouve sur sol calcairecalcaire, sec et filtrant. Le maquismaquis se trouve sur sol siliceux. En France, la garrigue occupe 400.000 ha, en Provence et Languedoc.

La garrigue était le lieu d'une importante activité préhistorique et médiévale :
- troupeaux de chèvres ou de moutons ;
- alimentation des fours dès le Moyen Âge (verre et fer) ;
- charboncharbon de boisbois ;
- fours à chauxchaux ;
- écorces à destination des tanneurs ;
- lavandelavande sauvage, l'aspic, pour la distillation ;
- oliviers et vigne, en terrassesterrasses.
Tout ceci disparaît avec l'exode rural.
Plantes caractéristiques de la garrigue
- Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis)) appelée aussi œilœil bleuetbleuet de Montpellier ;

- Arbousier (Arbutus unedo), appelé parfois arbrearbre à fraisefraise. Ses fruits de couleur rouge-orange, les arbousesarbouses, peuvent se consommer ;

- Asphodèle (Asphodelus), une plante vivace appartenant à la famille des Liliacées ;
- Camélée (Cneorum tricoccon), la camélée à trois coques, un arbrisseau à petites fleurs jaunes ;
- Chêne kermès (Quercus coccifera), un arbre à feuilles persistantesfeuilles persistantes, appelé aussi chêne de garrigue ;

- Chêne vert ou yeuse (Quercus ilexQuercus ilex), un arbre à feuilles persistantes qui ressemblent à celles du houx ;
- ChèvrefeuilleChèvrefeuille, étrusque (Lonicera etrusca) ou entrelacé (Lonicera implexa), des arbustes grimpants ;
- Ciste cotonneux (CistusCistus albidus), un arbrisseau typique de la garrigue, sa fleur à l'aspect chiffonné fait toute sa beauté.

Mais aussi :
- la filaire à feuille étroite (Phillyrea angustifolia) ;
- la filaire à feuille large (Phillyrea latifolia) ;
- le genévrier cade ou oxycèdre (Juniperus oxycedrus) ;
- le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea) ;
- le genêt scorpion ou genêt épineux (Genista scorpius) ;
- le lentisque ou pistachier lentisque (Pistacia lentiscus) ;
- le nerprun alaterne (Rhamnus alaternus),
- l'oléastre (Olea sylvestris) ;
- le pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) ;
- le romarinromarin (Rosmarinus officinalis) ;
- la salsepareille (Smilax aspera) ;
- le fragon ou petit houx (Ruscus aculeatus) ;
- le thym (ThymusThymus vulgaris).

Des forêts disparues
Il y a 5.000 ou 6.000 ans, la forêt recouvrait tous ces espaces. Les chênes verts faisaient 20 mètres de haut. Le sous-bois, dense et humide était riche. Elle avait pu s'installer après les longues périodes froides, après les bouleaux et les rennesrennes. L'Homme de Néandertal y a chassé. Il y a 4.000 ans, des peuples s'installent qui savent faire des outils en cuivre, en bronzebronze, domestiquer le mouton et le bœuf, semer et récolter l'orgeorge et le pois. Et, bien sûr, utiliser le bois.
Les progrès et l'augmentation de population épuisent ces sols pauvres : le défrichement ne va plus cesser, il sera important au Moyen Âge, mais c'est vers 1850 que le défrichement atteindra son maximum. Mais, ici, la forêt est lente à se reconstituer et l'eau des oragesorages érode plus qu'elle n'arrose ! Ces exploitations ont disparu avec la société urbaine et la forêt peine à revenir. Il faut considérer la garrigue pour ce qu'elle est : un milieu naturel malgré tout.