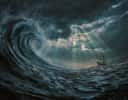Que recouvre le terme de « biodiversité » inventé au milieu des années 1980 ? S'il traduit bien la notion de vie sur Terre, il n'en saisit pas son principe essentiel, à savoir cette interdépendance des formes de vie. À l'heure où nombre de menaces pèsent sur la Planète, deux scientifiques nous exposent pourquoi il nous faut mieux repenser la valeur de la nature dans notre système économique pour mieux affronter et résoudre la crise écologique.
au sommaire
À quelques semaines de l’ouverture de la COP26, il faut rappeler que l'année 2021 n'est pas seulement un moment de vérité pour la réponse globale au dérèglement climatique. Elle l'est tout autant pour la préservation de la biodiversité mondiale, qui menace de s'effondrer alors même qu'elle sous-tend le bien-être humain.
Si un consensus large se dégage désormais sur la nécessité de réformer en profondeur des systèmes économiques devenus autodestructeurs, car visiblement occupés à saper leurs fondations écosystémiques, deux approches s'opposent quant au chemin à suivre.
Or, il faut rapidement pouvoir y voir clair pour espérer faire les bons choix, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et plus précisément de la COP15, qui se déroulera en deux temps, en ligne en ce mois d'octobre, puis en avril 2022.
L’approche séparatiste
L'approche aujourd'hui dominante, que nous qualifions ici d'approche séparatiste, ne vise pas seulement à ériger une frontière étanche entre systèmes sociaux et naturels mais à fractionner et isoler les systèmes naturels eux-mêmes en les instrumentalisant, en les réifiant et en les monétisant afin de les mettre à contribution pour nourrir une nouvelle forme de croissance économique, parfois qualifiée de « croissance verte », mais qu'il paraît plus juste de nommer « bio-croissance » : la croissance du produit intérieur brutproduit intérieur brut (PIB) tirée de l'exploitation du vivant. Cette approche, qui a sa cohérence, répond à deux logiques imbriquées.
D'une part, il s'agit de prendre acte de la domination des impératifs économiques (revenu, profit, croissance) sur les dynamiques naturelles et sociales pour les généraliser à toutes les interactions humaines, y compris les transactions non marchandes, de loin les plus nombreuses. D'autre part, dans ce cadre, il importe de chercher des solutions pratiques au problème censé être la clé de voûte de la crise de la biodiversité : la valeur de la nature.
L'approche séparatiste repose ainsi sur un triptyque : séparer le monde vivant du monde social en faisant de la croissance économique une boussole, pétrifier le monde vivant au moyen du « capital naturel » et le fragmenter en tarifiant les espèces non humaines sous prétexte de les préserver (en traitant le vivant comme une externalité).
Le rapport Dasgupta
Cette option a imprimé sa marque sur le débat public ces derniers mois avec la publication coup sur coup du rapport Dasgupta sur « l’économie de la biodiversité » et du nouveau cadre de comptabilité « économique et écologique » adopté sous l'égide des Nations unies.
Le rapport Dasgupta (2021) proclame ainsi sans détour dès ses premières pages que la crise de la biodiversité résulte d'un défaut d'optimalité dans la « gestion de portefeuille des actifs naturels » dont l'humanité a la charge. « Les trois caractéristiques omniprésentes du monde naturel - mobilité, silence et invisibilité - empêchent les marchés d'enregistrer de manière adéquate l'utilisation que nous faisons des biens et services de la nature ».
Vidéo portant sur le rapport Dasgupta en présence de l’auteur. © GreenAllianceUK, Youtube, 2020
Il faut donc, selon le rapport, y remédier à l'aide des instruments économiques qui peuvent aboutir à figer par les prix l'information économique que les marchés vont ensuite rendre publique. La nature, rendue à sa vocation économique, sera alors immobile, bruyante et tangible.
L'approche séparatiste qui irrigue le rapport Dasgupta débouche logiquement sur le projet de bio-croissance, explicité par Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, qui fut le commanditaire de ce travail quand celui-ci lui fut remis : « La biodiversité n'est pas seulement un idéal, c'est un élément essentiel de notre croissance économique ».
Le System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting (2021) rend, quant à lui, explicite le lien entre fragmentation et monétarisation, en proposant de généraliser cinq comptes nationaux principaux en complément du PIB.
Un second chemin
Le second chemin que nous proposons, avec de nombreux autres, de suivre ici diverge radicalement de cette approche séparatiste. Il consiste en une approche holistique des systèmes sociaux et naturels qui remet l'économie à sa juste place et repose sur une notion intuitive : la bio-solidarité. Car, si le terme de biodiversité, inventée au milieu des années 1980, saisit bien la variabilité de la vie sur Terre, il traduit mal son principe essentiel : l'interdépendance des formes de vie. Le monde vivant est non seulement un agrégat de flux, mais plus encore un ensemble de liens - c'est un réseau dynamique de relations naturelles et sociales - aujourd'hui en danger.
La bio-solidarité désigne ainsi l’interdépendance des différentes formes du monde vivant, dont les humains, et se mesure par la vitalité des liens qui unissent à la fois les espèces non humaines entre elles et ces espèces à l'espèce humaine.
“La valeur économique des ressources naturelles est en réalité très bien comprise et assimilée par celles et ceux qui en bénéficient”
L'indicateur clé de la vitalité n'est pas la variété mais la solidarité. La bio-solidarité vise donc, non pas à comptabiliser ou inventorier des espèces mais à reconnaître et identifier des liens, naturels et sociaux. L'approche holistique de la préservation de la biodiversité fait donc de la santé la grande médiation entre espèces et souligne le rôle des liens sociaux dans cette « pleine santé », liens patiemment tissés depuis des siècles par les communautés indigènesindigènes du monde entier.
À nos yeuxyeux, la raison essentielle de la destruction de ces liens n'est pas la valeur de la nature ou son défaut supposé mais la nature de la valeur, étroitement économique, et ses excès.
Les écosystèmes et la biodiversité qui les sous-tend ne souffrent pas d'un manque de valorisation mais d'un conflit de valeurs qui tourne aujourd'hui à l'avantage de la valeur économique au détriment de toutes les autres. Car l'hypothèse de la valeur manquante est aussi douteuse que contestable et peut aisément être renversée.

La valeur économique des ressources naturelles est en réalité très bien comprise et assimilée par celles et ceux qui en bénéficient, c'est précisément la raison des asymétries de pouvoir qui s'exercent pour se l'approprier ; il est utile de consulter sur ce point l’article fondateur de l’économiste James Boyce paru en 1994.
Une confrontation nécessaire
La confrontation de l'approche séparatiste et holistique de la biodiversité est à notre sens inévitable et même souhaitable : ces deux paradigmes s'opposent radicalement et depuis longtemps au demeurant sous des formes diverses (on pense ici à la controverse Buffon-Linné par exemple).
“La confrontation de l’approche séparatiste et holistique de la biodiversité est à notre sens inévitable et même souhaitable ”
Cette opposition prend pour l'heure la forme d'une contradiction manifeste entre deux textes de la Convention sur la diversité biologiqueConvention sur la diversité biologique (CDB), l'un d'avril 2021, l'autre de juillet 2021.
Dans le premier texte, la CDB annonce la mise en chantier d'une nouvelle stratégie santé-environnement qui repose sur des bases conceptuelles très différentes conduisant à des politiques publiques informées par la santé humaine, le droit et la justice sociale. Mais, en juillet 2021, la même CDB promeut « un cadre global pour la biodiversité post-2020 », dans lequel la comptabilité économique du vivant fait figure d'objectifs prioritaires.
Il faut aujourd'hui trancher cette contradiction en faveur de l'approche holistique plutôt que de prolonger l'improbable compromis actuel, par lequel on proclame vouloir favoriser l'approche holistique pour dans les faits donner toujours plus la priorité à l'approche séparatiste.
Quatorze merveilleux biomes pour rêver de notre belle Planète
Dans les régions tropicales et subtropicales chaudes où les précipitationsprécipitations ne sont pas suffisantes à maintenir un couvert arboré étendu, ce sont des prairies, des savanes et des terres arbustives qui se développent.
Lorsqu'elles sont parsemées d'arbresarbres, on parle de savane. Lorsque l'on y trouve plutôt des arbustes, c'est le terme de brousse qui est préféré. Et lorsque ces paysages sont entièrement dominés par les herbes, on parle de prairie.
Ce biomebiome est présent sur presque tous les continents, mais essentiellement tout de même, du côté de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Ici, il est joliment sublimé par la lumièrelumière irréelle d'un ciel menaçant. © AndreasGoellner, Pixabay, DP