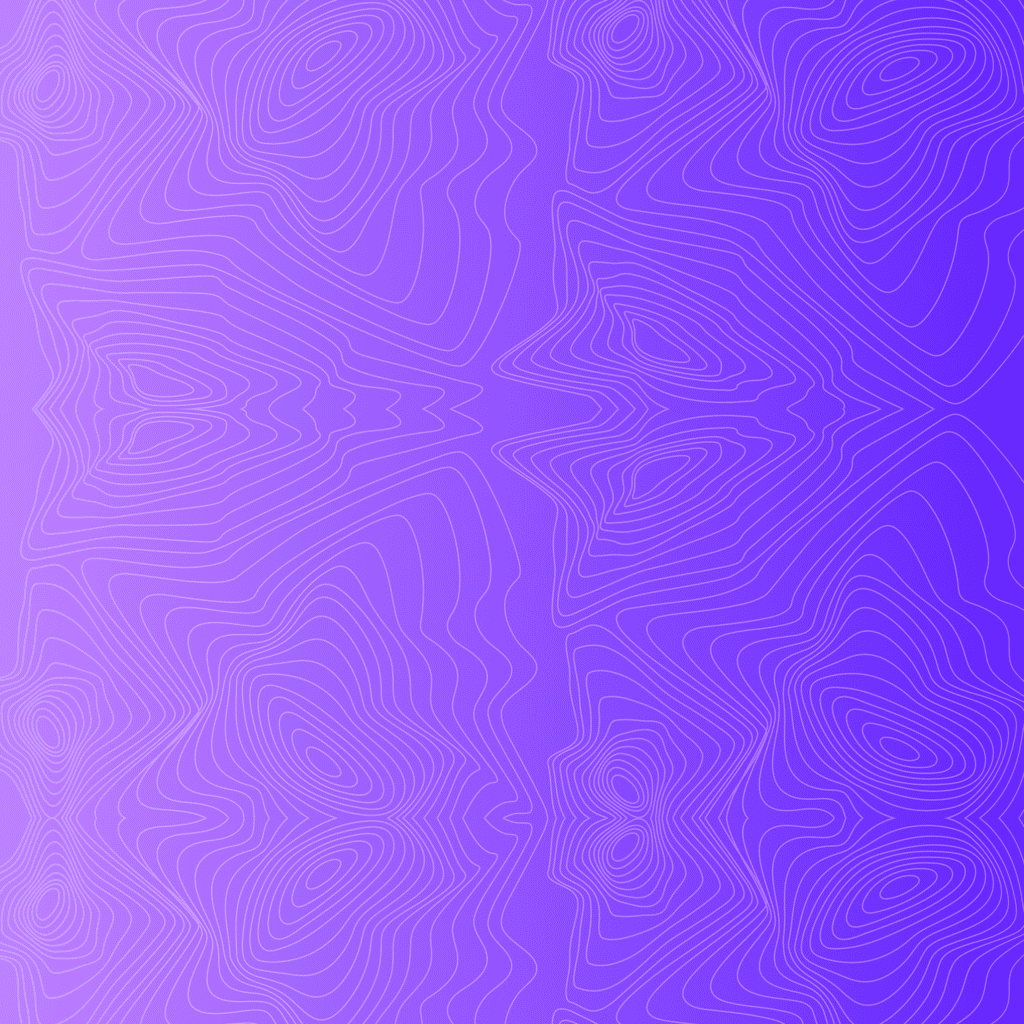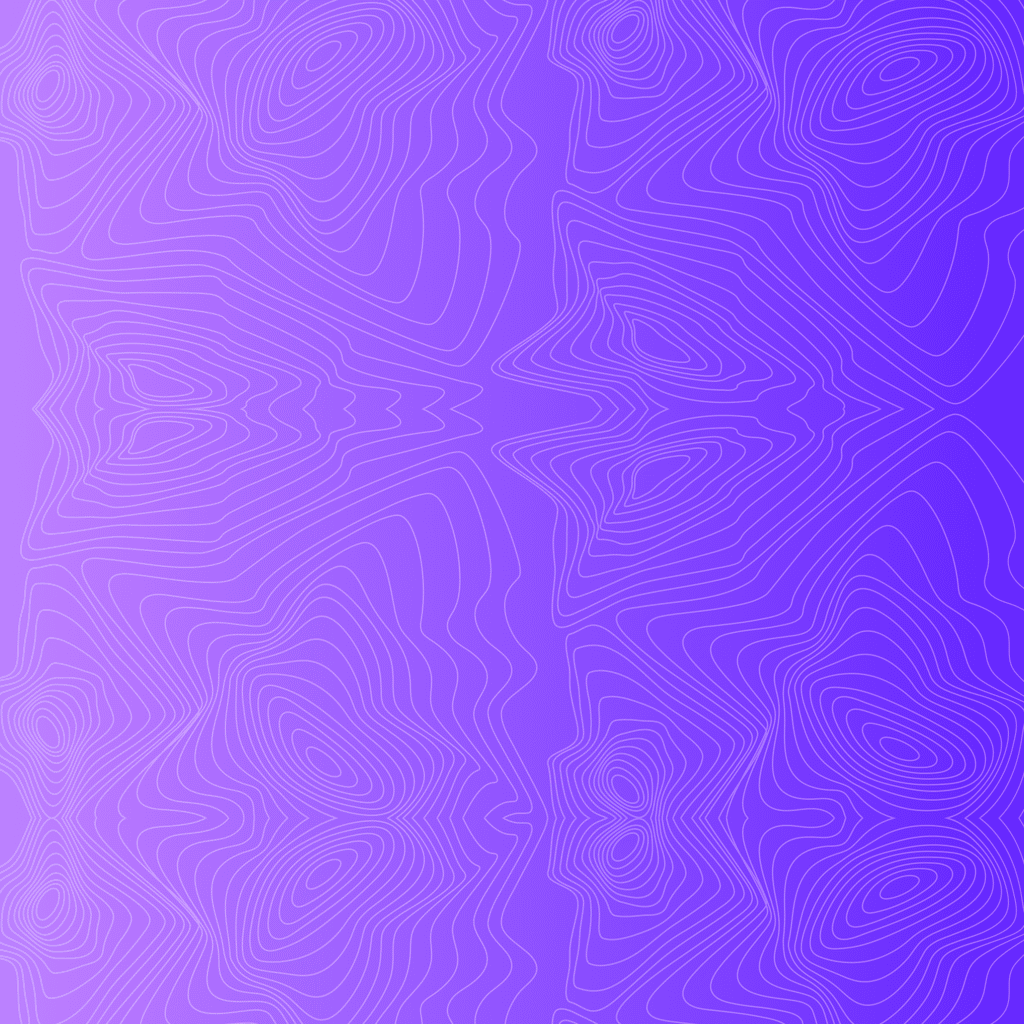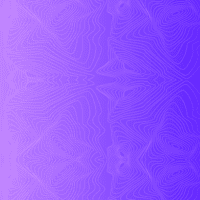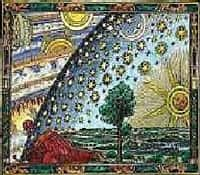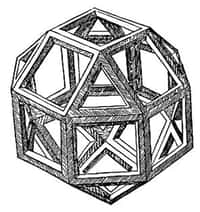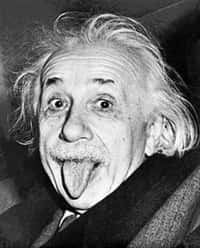au sommaire
Mon père était médecin et ma mère, dans sa jeunesse, avait été infirmière. Ma famille comprend trois générations de médecins et je suis le seul, peut-être, à ne pas avoir suivi la tradition, puisque mon cousin et mon fils sont également médecins.
Je suis né à Paris, le 24 octobre 1932 ; pour des raisons de santé, je n'ai pas fréquenté l'école avant la classe de cinquième. Ma mère me donnait des leçons et m'apprit l'anglais en me lisant les livres de Jérôme K. Jerome, tels que "Trois Hommes dans un bateau." Je passai mon enfance à la montagne, à Villars-de-Lans, puis à Barcelonnette, près de la frontière italienne, où je vécus les années de guerre. La région, occupée par les Italiens, possédait une communauté juive, en principe internée, mais en fait libre de ses mouvements, si ce n'est la présence obligatoire à l'appel qui avait lieu chaque jour, à midi, sur la place du village ; en revanche, quand les Allemands prirent les choses en main, après la capitulation de l'Italie, les Juifs durent se réfugier dans des cabanes en pleine montagne, en butte au froid et à la faim. Dès l'annonce du débarquement allié en Normandie, la RésistanceRésistance voulut s'imposer, mais, après trois semaines de parachutages et de fêtes populaires, les Allemands effectuèrent un retour en force en décrétant la loi martiale. J'avais alors douze ans, et j'étais seul à Barcelonnette (ma mère était absente, mon père était mort d'une crise cardiaquecrise cardiaque trois ans auparavant) ; je dormais à la maison et, matin et soir, j'allais prendre mes repas au collège, occupé par les Allemands. Un jour, je fus agrippé par quatre sentinelles allemandes qui surveillaient l'entrée du collège, et plaqué contre un murmur ; face aux fusils braqués sur moi, je crus ma dernière heure arrivée, mais les soldats désiraient seulement empêcher le gamin que j'étais de voir fusiller des prisonniers derrière le mur.
Revenu à Paris en 1945, mes préférences allaient vers les disciplines littéraires, grâce à mon éducation classique de latin et de grec ; par la suite, sous l'influence de quelques professeurs remarquables au lycée Claude-Bernard, j'optai pour les sciences. En 1949, je me suis engagé dans une préparation au concours d'entrée de l'Ecole Normale Supérieure assez originale pour l'époque - il s'agissait du NSE (Normale Sciences Expérimentales), qui cumulait la biologie, la physique et la chimie. C'était un programme extrêmement stimulant, qui m'initia à ce que j'ignorais totalement: l'art de Inobservation ; en effet, l'éducation que j'avais reçue jusque là - comme, en général, toute l'éducation française - était surtout marquée par la réflexion abstraite et dépourvue d'observation. De plus, comme le NSE était en partie consacré à la biologie, les professeurs étirent l'excellente idée de nous envoyer faire des stages dans des laboratoires de biologie. C'est ainsi que je me retrouvai au laboratoire de biologie marine de Banyuls, où l'on peut observer aussi bien le fond de la mer que les grottes du massif montagneux des Albères, dans l'arrière-pays. J'y appris à regarder et à dessiner ce que j'avais observé, ainsi qu'à travailler sur des animaux et des végétaux. C'est là une formation excellente, qui fait cruellement défaut dans les programmes actuels.
Mes débuts à l'Ecole Normale, à partir de 1951, ne méritent guère de commentaire, sauf sur un point important. En 1953, je suivis une session à l'Ecole d'été de physique théorique, aux Houches, qui venait d'être créée par une femme courageuse, Cécile de Witt. Il faut rappeler qu'à la suite d'une cascade de coups durs, tels que l'hécatombe de 1914 ou la panique de 1940, la physique française avait été durement touchée et de nombreux chercheurs avaient trouvé la mort ou choisi l'exil ; il s'ensuivait que l'enseignement de la physique était extrêmement déficient dans les universités françaises, après la guerre. Cécile de Witt avait compris à quel point il était important que les étudiants et les jeunes chercheurs français puissent apprendre la physique nouvelle et elle avait alors convaincu Albert Laprade, l'un des grands architectesarchitectes de l'époque, de lui prêter un ensemble de beaux chalets situés derrière les Houches, avec une vue magnifique sur le massif du Mont Blanc. Elle avait trouvé, d'autre part, les fonds nécessaires pour ce projet grâce à la contribution des universités et de donateurs. Elle réussit à persuader quelques uns des plus grands chercheurs de l'époque de donner des cours à l'Ecole.
Les participants étaient logés dans les différents chalets. Je partageais avec deux ou trois autres étudiants le chalet qui hébergeait aussi la famille Peierls. Sir Rudolf Peierls était un grand physicienphysicien anglais d'origine allemande, qui avait crée une école de pensée sur la théorie quantique des solides. Le soir, devant la cheminéecheminée, nous retrouvions Schockley, l'un des inventeurs du transistor, qui venait raconter des histoires. Au coin du feu, on voyait aussi le physicien suisse alémanique Wolfgang PauliWolfgang Pauli, un homme d'un calme tout germanique, l'un des fondateurs de la mécanique quantiquemécanique quantique. Nous écoutions les histoires de Schockley, qui nous faisaient tous bien rire - à l'exception de Pauli, qui attendait que nous ayons fini pour sourire. Les jeunes étudiants que nous étions alors se trouvaient ainsi confrontés, subitement, aux grands fondateurs de la science contemporaine. Cela se passait dans un paysage champêtre, au détour de petits sentiers, dans la boue, dans les chalets, sans organisation réglementaire comme c'est le cas actuellement. Durant les deux mois d'été, nous étions en contact direct avec l'ensemble de la recherche physique. Nous en ressortions complètement exténués, mais profondément désireux d'en savoir davantage. Nombre de mes collègues de cette génération, tel mon ami Philippe Nozières, ont été marqués par cette expérience des Houches. L'Ecole d'été existe toujours, mais elle répond maintenant à des fonctions différentes, plus spécialisées. Elle a gardé le niveau extraordinaire que Mme de Wiu avait réussi à lui donner.
Durant mon séjour à l'Ecole Normale, trois personnages m'ont particulièrement impressionné. Le premier est Yves Rocard (le père de Michel Rocard), qui donnait une vitalité exceptionnelle à la maison ; c'était un homme plein d'humour, de vie, de curiosité, qui s'intéressait aussi bien à l'astrophysiqueastrophysique qu'à la mécanique ou à la physique de l'atmosphèreatmosphère. Il avait participé activement à la Résistance, notamment en renseignant les Anglais sur les constructionsconstructions allemandes des fuséesfusées V 2. Le second était Alfred KastlerAlfred Kastler, un Alsacien calme et affable, qui savait prodiguer un enseignement simple et clair dont nous tirions le plus grand profit ; il avait fondé une école d'optique qui a été illustrée en 1966 par le prix Nobel. Il y avait enfin un troisième personnage, bien différent, Pierre Aigrain ; c'était un ancien élève officier de marine, parti aux Etats-Unis durant la seconde guerre mondiale ; pilote de chasse maladroit il s'était orienté vers la recherche scientifique. Revenu en France, il a été l'un des principaux fondateurs de l'école française des semi-conducteurssemi-conducteurs, qui a pris par la suite une importance considérable. J'ai passé un an dans le laboratoire qu'il venait de créer, dans des conditions passablement folkloriques: je faisais montre d'une maladresse extraordinaire et je me rappelle une manipulation qui tirait des cristaux de siliciumsilicium ou de germaniumgermanium (aujourd'hui utilisés couramment en microélectronique) à 1500° sous une atmosphère d'hydrogènehydrogène, dans un système que nous avions bricolé avec de vieilles machines-outils ; la moindre fuite pouvait faire exploser tout le bâtiment et, de temps en temps, pris de panique, nous plongions sous les meubles... En définitive, cependant, les expériences marchaient assez bien et Pierre Aigrain nous apprenait quantité de choses.
Je dois dire que je suis un exemple typique d'une carrière orientée selon des critères stupides. En sortant de l'Ecole Normale, après avoir passé, en 1955, l'agrégation de physique, j'hésitai entre plusieurs laboratoires. A l'époque, j'était déjà marié et père de, famille, et je ne pouvais donc me permettre n'importe quoi. Un beau jour, le professeur J. Yvon, de Saclay, patron des théoriciens et grande autorité scientifique, m'appela au téléphone: «J'ai envie de vous voir travailler chez moi ; j'envoie une voiturevoiture vous chercher.» C'est ainsi que je me retrouvai au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.)), qui venait d'être construit à Saclay. Je pus y admirer d'immenses accélérateurs, des piles atomiques et autres installations majestueuses. L'ensemble donnait une impression d'activité extraordinaire et, sans plus réfléchir, je signai un contrat d'ingénieur.
Ma décision était vraiment stupide, car fondée uniquement sur des apparences. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, car Saclay était vraiment un centre très vivant, animé par une génération de chercheurs qui avaient reçu leur formation à l'étranger juste après la guerre, grâce à une politique intelligente du C.E.A. Ils s'étaient mis à prêcher ce qu'ils avaient appris et leurs idées ne tardèrent pas à nous captiver. Parmi eux, je citerai Claude Bloch qui, malheureusement, est mort très jeune, Messiah, qui enseignait la mécanique quantique, Anatole Abragam, qui enseignait la résonancerésonance magnétique, Jacques Friedel, qui faisait office de consultant en physique des solides. J'ai souvenir de n'avoir fait alors que ce qui m'intéressait, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, et la plupart du temps sans aucun succès. Le système alors en vigueur était bien différent de celui qui a cours actuellement, où l'on est tenu dans le cadre d'un sujet de recherche précis, sous l'égide d'un directeur pointilleux... En ce temps-là, je pouvais discuter librement avec Bloch, Friedel, Abragam, et confronter leurs avis avant de suivre leurs conseils. A la fin de 1957, je me décidai à concocter une thèse sur la théorie de la diffusiondiffusion de neutronsneutrons par les milieux magnétiques.
En 1958, je partis passer un an à l'université de Californie, à Berkeley ; c'était à l'époque une université provinciale, calme, fleurie et d'un haut niveau scientifique ; les gens étaient décontractés, ce qui ne les empêchait pas de faire preuve d'une grande efficacité. Mes journées de travail étaient courtes, mais à mon sens «intelligemment détendues» ; j'étais étonné d'avoir l'impression de travailler si peu, alors qu'en réalité je faisais pas mal de choses. J'ai travaillé à Berkeley avec un maître de la physique des solides, Charles Kittel, doué d'une autorité de ferfer et d'un caractère particulièrement tranchant ; il lui arrivait d'interrompre l'exposé de l'un de ses étudiants en termes sans équivoque: «Ce n'est pas la peine que vous continuiez le séminaire, vous n'avez rien compris au sujet !» Je garde malgré tout un excellent souvenir de cette ambiance «musclée».
Malheureusement, après neuf mois de séjour à Berkeley, je fus obligé de rentrer précipitamment en France pour accomplir mon service militaire, en pleine guerre d'Algérie. Je fus d'abord affecté à Brest, puis je passai une brève période au Sahara, lors de nos premiers essais nucléaires, avant de revenir en région parisienne pour effectuer des travaux de recherche fondamentale. Il était, certes, difficile d'entretenir une famille de trois enfants avec une solde de marin de seconde classe, puis d'élève officier, mais je ne me plaignais pas car mon temps libre me permettait de réfléchir à divers thèmes de recherches : au bout du compte, ces vingt-sept mois n'auront pas été trop stériles.
En 1961, je me retrouvai maître de conférencesmaître de conférences à la nouvelle faculté d'Orsay pour enseigner la mécanique quantique et tenter de me lancer dans la recherche théorique. Un jour, je me suis retrouvé face à l'un de mes anciens camarades du service militaire, qui travaillait dans une compagnie privée. «Je voudrais venir chez toi, me dit-il, et faire une thèse expérimentale.» Je n'avais guère de compétences dans ce domaine mais, pris de je ne sais quelle folie, j'ai lancé en réponse: «D'accord, on va faire un groupe expérimental.» Rétrospectivement ce pari me semble absurde: le groupe ainsi projeté aurait pu s'effondrer dramatiquement mais j'avais de la chance, et je réussis à mettre sur pied une unité de recherche expérimentale. Aigrain me fit attribuer certains locaux, très difficiles à obtenir ; quelques expérimentateurs chevronnés, tels Guinier et Perio, m'aidèrent à construire un bâtiment et à implanterimplanter le laboratoire. Surtout, j'eus un coup de chance en recrutant quatre «mousquetaires», chercheurs débutants de classe exceptionnelle, disposés à collaborer. Leurs origines étaient pourtant très différentes : l'un venait de l'université de l'Illinois, à Urbana, où il avait travaillé dans les dommages de radiations (ce qui n'avait rien à voir avec nos projets) ; l'autre venait d'une compagnie d'informatique, le troisième, originaire de Strasbourg, était déjà un chercheur confirmé et le quatrième venait d'achever ses études à Marseille. Nous avons pourtant réussi à trouver un thème commun: l'étude des matériaux supraconducteurssupraconducteurs. Une révolution majeure venait en effet de se produire, en 1957-1960, en physique de l'état condensé., après 50 ans de vains efforts, on commençait enfin à comprendre ce qu'était un supraconducteur, c'est-à-dire un métalmétal où le courant passe sans subir aucune perte. Ayant persuadé quelques jeunes théoriciens d'Orsay de créer une unité de recherche théorique et de se fédércr à l'unité expérimentale dans un programme commun sur les supraconducteurs, nous nous mîmes au travail, dans des conditions passablement artisanales.
La première année fut marquée d'une grande anxiété. Nous voulions, en effet, fabriquer des «jonction tunnels», indispensables pour nos recherches ; or la recette en était introuvable. Nous devions en même temps affronter la concurrence acharnée d'autres laboratoires français, qui n'étaient pas particulièrement ravis de voir une équipe de jeunes gens empiéter sur leur domaine. Heureusement, au bout d'un an, la théorie vint à notre secours : l'un des «mousquetaires», Guyon, avait écrit avec moi un petit article sur certains effets assez fins dans des films «en sandwich», et il s'était rendu en Angleterre pour parler de nos résultats. Les Anglais ayant manifesté un grand intérêt Guyon leur raconta nos tentatives pour obtenir des jonctions ; c'est alors qu'ils lui révélèrent une astuce inédite, qui consistait à faire une décharge dans la chambre à vide. Grâce à ce procédé, notre groupe expérimental peut amorcer ses recherches. Pendant près de cinq ans, nos articles majeurs furent publiés en commun par les théoriciens et les expérimentateurs, sans nom d'auteur, sous la dénomination «Groupe supraconducteurs, Orsay» (les publications courtes ou individualisées se poursuivaient néanmoins avec les noms d'auteurs, pour permettre aux jeunes chercheurs de se faire connaître). Notre groupe acquit une certaine réputation et parvint notamment à établir qu'il existait certains régimes spéciaux où seule la surface d'un spécimen devenait supraconductrice en présence d'un champ magnétiquechamp magnétique ; cette «supraconductivitésupraconductivité de surface» donnait une réponse à pas mal de questions.
A partir de 1966 environ, la recherche sur les supraconducteurs s'orienta plutôt vers l'étude des matériaux, ce qui la restreignit à quelques laboratoires métallurgiques très équipés. Plusieurs branches de la physique des solides connaissaient une évolution analogue, qui imposait des reconversions. C'est alors que je décidai de me lancer dans la chimie physique, qui ouvrait de vastes perspectives. Après quelques hésitations, en quête d'un nouveau secteur de recherches, nous avons opté pour les cristaux liquidesliquides, un thème qui n'avait rien à voir avec nos précédents travaux ; à l'époque, ce type de cristaux, que l'on utilise par exemple dans les montres à affichage, semblait aussi intéressant que mystérieux. En 1969, nous réussîmes à convaincre sept équipes d'Orsay (optique, résonance nucléaire, défauts, chimie, rayons Xrayons X, hydrodynamique et théoriciens) d'abandonner leurs recherches traditionnelles et de mettre leur savoir en commun, en formant le «Groupe cristaux liquides, Orsay», qui produisit lui aussi diverses publications sans nom d'auteur afin d'encourager le travail collectif. Grâce à nos efforts, la France, qui avait été dans les années 1920 à l'avant-garde des travaux sur les cristaux liquides, peut retrouver sa prééminence. Cependant, nous avons commis l'erreur de négliger les applicationsapplications des cristaux liquides : en ce temps où l'ensemble de l'économie était en plein essor, où la science ne connaissait pas de problèmes de financement, les questions économiques ne nous préoccupaient guère et nous ne nous sommes pas souciés de prendre des brevets ; aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte de notre légèreté. La France est donc un pays important en recherche fondamentale sur les cristaux liquides, mais elle détient relativement peu de brevets.
Après les cristaux liquides, je m'intéressai à la physique des polymèrespolymères (les longues moléculesmolécules que l'on utilise pour fabriquer les matières plastiquesmatières plastiques) ; c'était un domaine fertile, mais insuffisamment développé en région parisienne. J'ai donc commencé à faire un peu de recherche théorique dans cette spécialité.