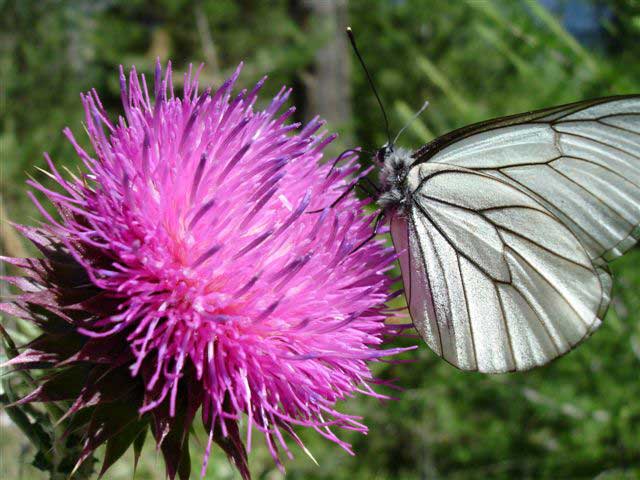au sommaire
La pivoine est une plante herbacée mesurant entre 60 cm et 80 cm de haut. Ses racines renflées en tubercules, ses grandes feuilles d'un vert brillant divisées en folioles allongées la font aisément reconnaître. Ses fleurs sont larges, inodores et d'une belle couleurcouleur rouge vif. Mais il y en a aussi de très belles, roses ou blanches... Ses fruits sont des follicules dressés s'ouvrant par une fente, et renfermant de nombreuses graines globuleuses.
En phytothérapiephytothérapie, seule la racine de la pivoine est utilisée. Séchée puis fragmentée, elle est employée en infusioninfusion ou en décoction. La mythologie raconte que c'est le dieu guérisseur grec Paeon qui aurait découvert les propriétés médicinales de la pivoine, appelée aussi rose de la Pentecôte. Son nom scientifique rappelle d'ailleurs cette légende. La pivoine porteporte le nom latin de Paeonia officinalis.
La pivoine, anti-inflammatoire et antidouleur
La substance activesubstance active contenue par la racine de pivoine est la paeoniflorine. Elle a de puissants effets analgésiquesanalgésiques, anti-inflammatoires, antispasmodiquesantispasmodiques et sédatifs. Ils sont appréciés pour le traitement des rhumatismes, mais aussi contre les spasmes gastrogastro-intestinaux, certaines aménorrhéesaménorrhées et les dysménorrhéesdysménorrhées, c'est-à-dire des interruptions ou des douleursdouleurs pendant les périodes de règles. En usage externe, la racine serait aussi indiquée contre l'eczéma atopique et les douleurs rhumatismales.
En cas d'utilisation par voie interne et en cas de surdosage, les racines peuvent entraîner des gastroentérites. En outre, leur consommation est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes.
Sources :
- Phytothérapie, la Santé par les plantes, Vidal Éditeur
- Plantes médicinalesPlantes médicinales, Gründ
Phytothérapie
Note. La phytothérapie est utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles. Son efficacité et son innocuité restent toujours discutées. Et pour cause, comme l’explique l’Organisation mondiale de la Santé dans un rapport de 1998, « un nombre relativement petit d'espèces de plantes ont été étudiées pour d’éventuelles applications médicales ». Cet article s’inscrit naturellement dans cette démarche. Ajoutons que compte tenu des risques éventuels d’effets indésirables, d’interactions médicamenteuses voire de toxicité de certaines plantes, informez toujours votre médecin, si vous recourez régulièrement à la phytothérapie.
Bibliographie :
- Guide des plantes qui soignent, édition Vidal, 2010.
- L'Encyclopédie des plantes médicinales, édition Larousse, 2001 et 2017.
- Les plantes médicinales, Institut européen des substances végétales, mars 2015.
- Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy, éditions Leduc.s, 2017.
- Les huiles essentielles chémotypées, Dominique Baudoux et M.L. Breda, édition JMO.