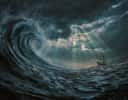De plus en plus de stations balnéaires interdisent de fumer sur leurs plages car si fumer nuit gravement à la santé, fumer constitue aussi une considérable source de pollution pour l'environnement à cause des mégots négligemment jetés et enfouis dans le sable. Des chercheurs ont entrepris d'étudier l'impact de ces filtres à cigarettes, très faiblement biodégradables, dans l’environnement marin en Tunisie.
au sommaire
Les mégots de cigarettes, qui sont les principaux déchets plastiques retrouvés dans l'environnement, peuvent représenter jusqu'à 40 % des déchets ramassés sur les plages de Méditerranée. Chaque année, plus de 6.000 milliards de cigarettes sont fumées dans le monde, pouvant conduire à plus d'un demi-million de tonnes de mégots rejetés dans l’environnement.

Conséquences du mégot de cigarettes sur le milieu marin
Malheureusement, ces mégots composés principalement de matière plastiquematière plastique sont très faiblement biodégradables. En outre, ils contiennent de nombreux composés toxiques issus de la combustioncombustion qui peuvent menacer les organismes vivants. Pourtant, nous connaissons actuellement très peu de choses sur le devenir des mégots dans les écosystèmes marins et leur impact sur la faune et la flore marine.
“Chaque année, plus de 6.000 milliards de cigarettes sont fumées dans le monde”
Les chercheurs de l'Institut méditerranéen d'océanologie (MIO, France) et de l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM, Tunisie) se sont donc donné comme objectif d'évaluer l'impact des mégots de cigarettes sur la diversité des micro-organismesmicro-organismes et la libération de métauxmétaux dans l'environnement marin en Tunisie.
Ils ont montré que les mégots de cigarettes augmentaient les concentrations en ferfer, manganèsemanganèse et zinczinc dans le milieu marin et qu'ils contribuaient à l’acidification de l'eau de mer. Ils modifiaient la composition des bactériesbactéries présentes dans les sédiments de surface en favorisant le développement de bactéries généralement connues pour vivre dans des sites hydrothermaux sous-marins profonds, appelés « fumeurs noirsfumeurs noirs ».