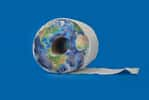au sommaire
Les inondationsinondations résultent de précipitationsprécipitations anormalement abondantes, entraînant la crue des cours d'eau ou la remontée des nappes phréatiquesnappes phréatiques saturées. Ce peut être aussi la conjonction entre une tempêtetempête et un niveau de la mer exceptionnellement élevé (fort coefficient de marée). Ainsi, la tempête Xynthia affecta particulièrement la Vendée le 28 février 2010 et fit 53 morts et plus de 6.000 sinistrés. La qualité et l'état du sol et du sous-sol jouent un rôle important.

Grenoble, quai Perrière : la célèbre fontaine du lion et du serpent, sculptée par Sappey en 1843, symbolise le perpétuel combat de Grenoble (le lion) contre les crues de l’Isère (le serpent). Une devise prévient « La serpen et lo dragon mettront Grenoblo en savon » (l’Isère, le serpent et son affluent le Drac, le dragon). © Guillaume Piolle, CC BY 3.0
Fleuves à risques d'inondation dans le monde
Certains grands fleuves, associés à un bassin versantbassin versant étendu, présentent des risques importants :
- Pô (Italie) ;
- Mississippi - Missouri (États-Unis) ;
- Yang-Tsé-Kiang (= fleuve bleu, Chine, 1.000.000 de morts en 1931) ;
- Huang-ho (= fleuve jaune, Chine, 3.700.000 de morts en 1931 et 2.000.000 en 1969) ;
- Gange (Bengladesh) ;
- Indus (Pakistan, plus de 1.700 victimes et 21 millions de sinistrés au cours de l'été 2010).
Les inondations en France
Ce type de risque, répandu en France métropolitaine mais avec une intensité moindre, concerne 10 % du territoire, soit une commune sur trois, car notre pays possède 280.000 km de cours d'eau et de côtes.
La Seine entre régulièrement en crue, tous les dix ans en moyenne, avec une crue centennale exceptionnelle, la dernière en janvier 1910 (la Seine avait atteint 8,62 m à Paris, à comparer à la côte normale de 0,82 m !)).

À gauche, la célèbre statue du zouave du pont de l’Alma à Paris : lorsqu’il a les pieds dans l’eau (côte supérieure à 3,5 m), la Seine est en crue et les voies sur berges sont fermées. Lors de la crue de 1910, l’eau est arrivée à ses épaules ! À droite, sur le bâtiment situé à l’entrée du parc de Saint-Cloud est rivée une plaque indiquant le niveau atteint par la Seine en crue le 28 janvier 1910. © J.-M. Bardintzeff
Les crues et les inondations associées ont lieu en général en hiverhiver (entre le 15 novembre et le 15 mars), une période de précipitations abondantes sur un sol gelé ou saturé d'humidité. Des inondations ont assez souvent lieu aussi dans le Sud de la France (Gard, 8-9 septembre 2002, 21 morts, 11 disparus).
La dernière crue bicentennale de l'Isère a eu lieu le 2 novembre 1859 et a fait six morts (le niveau de la rivière était monté de 5 mètres).

Le Vernon en crue traverse la route entre Vizille et Vaulnaveys-le-Haut (département de l’Isère) le 23 août 2005. Un tel phénomène, en été, provient de températures anormalement élevées, ce qui se traduit par moins d’eau stockée en neige en altitude et un sol très sec donc difficile à imbiber. © J.-M. Bardintzeff

Saint-Gengoux. Inondation par la Grosne entre Saint-Gengoux-le-National et Bissy-sous-Uxelles (département de Saône-et-Loire) le 3 novembre 2008. © J.-M. Bardintzeff

Messeugne - La Grosne en crue à Messeugne (département de Saône-et-Loire) le 11 avril 2006. Une semaine plus tard, la rivière a retrouvé son lit. © J.-M. Bardintzeff