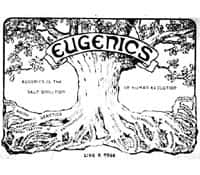La société du Moyen Âge est divisée en trois ordres : les nobles, les hommes d'Église et la paysannerie. Les paysans se placent sous la protection de seigneurs locaux (nobles) qui les défendent contre les pillards et autres bandits de grands chemins. Les seigneurs, quant à eux, se placent volontiers sous l'autorité de l'Église pour avoir plus d'emprise sur leurs sujets.
au sommaire
La société du Moyen Âge est principalement organisée autour des dogmes de l'Église catholique.
Les trois ordres de la société médiévale
Elle est divisée en trois ordres :
- bellatores (ceux qui combattent) : les nobles (princes, seigneurs, chevaliers) ;
- oratores (ceux qui prient) : les hommes d'Église ;
- laboratores (ceux qui travaillent) : les paysans (80 à 90 % de la population).
En ce qui concerne les rois et seigneurs occidentaux, ils se placent volontairement sous l'autorité de l'Église afin d'avoir plus d'emprise sur les esprits de leurs sujets. Ils deviennent des rois issus de la volonté divine. Plusieurs dynasties royales et impériales se succèdent pendant le Moyen Âge.
L'instabilité politique de la société du Moyen Âge
La stabilité politique de l'Empire romain laisse place à une grande instabilité, due à des guerres locales entre royaumes ou seigneuries limitrophes, mais aussi à des combats contre diverses invasions. On peut citer :
- les invasions arabomusulmanes, au VIIIe siècle ;
- puis les invasions normandes aux IXe et Xe siècles.
Puis vient l'époque des croisades, où nombre d'armées occidentales partent en Terre sainte défendre le tombeautombeau du Christ. À partir de 1199, l'Inquisition religieuse vient troubler la société du Moyen Âge, cette période de terreur va durer plusieurs siècles.

L'architecture fortifiée, comme celle du pont Valentré (XIVesiècle), à Cahors, dans le Lot, est le reflet de la société du Moyen Âge. © Phillip Capper, Fotopedia, CC by 2.0
La paysannerie au Moyen Âge : serfs et vilains
Au Moyen Âge, 80 à 90 % de la population est de condition paysanne, catégorie qui se divise entre :
- les serfs ;
- les vilains : les seigneurs ont droit de vie et de mort sur les vilains.
Les paysans se placent sous la protection de seigneurs locaux pour les défendre contre les pillards et autres bandits de grands chemins.
Châteaux du Moyen Âge
À cette époque, on construit un grand nombre de châteaux afin de protéger la population. Les seigneurs prêtent ou non serment d'allégeance à des dynasties royales. Ces allégeances marquent peu à peu le début de la notion d'État nation et, ainsi, la fin de l'époque féodale.
À savoir : le partage de la société du Moyen Âge en trois classes de population va se poursuivre jusqu'au XVIIIe siècle. La Révolution française réorganisera en profondeur l'organisation de la société.
À lire aussi sur Futura :
La splendeur des châteaux du Pays cathare
Le nom du château de Roquefixade (Ariège), qui signifie littéralement « roche fissurée », évoque l'énorme entaille naturelle comblée par la constructionconstruction d'une arche de pierre. La forteresse a servi de refuge et de lieu de résistancerésistance pour les albigeois (cathares) au XIIe siècle.
Altitude : 919 mètres.
© Sean Perry, Flickr, CC by-nc-nd 2.0