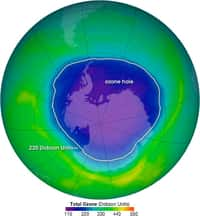au sommaire

Tubercules d'igname mis en vente sur un trottoir de la ville de Cotonou (Bénin, Afrique de l'Ouest). Dans les pneus se dressent des tubercules de plusieurs variétés en mélange de l'espèce cultivée Dioscorea rotundata. Au premier plan, au centre de la photo, on observe des petits tubercules de patate douce. A droite de la photo, se trouvent des cossettes d'ignames (en gris à l'arrière plan) et de manioc (en blanc au premier plan).
© IRD - © Serge Tostain
Reproduction et utilisation interdites
L'igname est une plante alimentaire majeure dans les zones tropicales. Des chercheurs de l'IRD et de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin ont analysé l'impact d'une pratique traditionnelle de culture sur la diversité génétiquegénétique des ignames au Bénin. Ils ont constaté qu'à travers l'ensemble du pays, des paysans collectent des ignames dans la savane ou la forêt afin d'ensemencer leurs champs. Les analyses génétiques ont montré que cette pratique permet d'enrichir la diversité des ignames cultivées, que l'on pensait figée en raison de leur multiplication habituelle par voie asexuée. Or, les agriculteurs créent des variétés correspondant à de nouvelles combinaisons génétiques produites par la reproduction sexuée des ignames sauvages et cultivées. Ce système, qui associe reproduction sexuée et asexuée, permet de maintenir et de diffuser les plantes les plus intéressantes, tout en préservant la capacité d'évolution de l'igname cultivée.
La conservation institutionnelle des ressources génétiques des plantes cultivées s'est longtemps appuyée sur les seules banques de gènesgènes. La reconnaissance du rôle des agriculteurs dans la genèse et le maintien de la diversité génétique des plantes cultivées a conduit à promouvoir au plan international des stratégies de conservation dans les agrosystèmes où cette diversité a évolué. Cependant, développer cette conservation in situ nécessite une meilleure compréhension des conséquences évolutives de l'utilisation de la diversité génétique par les paysans.

Inflorescences de l'espèce d'igname sauvage Dioscorea abyssinica apparentée à la forme cultivée D. rotundata. La taille des fleurs est relativement grande par rapport aux fleurs males des autres espèces et ne sont pas odorantes. La photo a été prise sur une plante dans la parcelle du Laboratoire de génétique de l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin).
© IRD - © Serge Tostain
Reproduction et utilisation interdites
Cultivée pour son tubercule, l'igname (Dioscorea spp.)) est une plante de grande importance alimentaire dans la zone tropicale. L'igname cultivée est multipliée par voie végétative, c'est-à-dire avec une reproduction asexuée : les champs traditionnels sont ensemencés avec des fragments de tubercules provenant des récoltes précédentes. Seules les mutations sont susceptibles d'enrichir ce patrimoine génétique alors qu'il est menacé d'érosion, notamment en raison de l'abandon de certaines variétés. Les espèces d'ignames sauvages, au contraire, se reproduisent sexuellement.
En Afrique de l'Ouest, des études ethnobotaniques ont rapporté une pratique particulière appelée "ennoblissement". Les cultivateurs collectent dans la savane ou la forêt des ignames sauvages et les plantent dans leurs champs. Après plusieurs années de culture, les plantes qui développent un tubercule de morphologiemorphologie proche de variétés cultivées sont choisies par le cultivateur pour être multipliées. Les processus biologiques impliqués dans la transformation morphologique du tubercule et son maintien à travers les générations sont inconnus, mais une équipe, associant des chercheurs de l'IRD et de l'Université d'Abomey-Calavi, a réalisé une analyse approfondie des conséquences génétiques de cette pratique au Bénin.
Les chercheurs ont étudié la nature génétique des ignames ennoblies par les cultivateurs. Ils ont collecté des tubercules soumis à ce processus, dans les champs d'un village au nord du Bénin, ainsi que des échantillons d'espèces sauvages provenant de la savane alentour, puis, ils ont caractérisé leur identité génétique. Pour élargir leur étude, des prélèvements ont été réalisés à travers le pays, afin de couvrir différentes situations géographiques, ethniques et écologiques.

Grenier traditionnel d"ignames. Cet agriculteur protège par un tas de broussailles les tubercules d'ignames qu'il utilisera pour ensemencer son champ. Village de Wari, sous-préfecture de Sinendé, nord du Bénin.
© IRD - © Pham, Jean-Louis
Reproduction et utilisation interdites
L'équipe a réalisé une analyse de paternité sur les descendances d'ignames sauvages et cultivées, afin de déterminer si celles-ci résultent de la fécondationfécondation par une plante mâle sauvage ou cultivée. Les résultats obtenus montrent l'existence d'hybridationshybridations spontanées entre une espèce sauvage et les ignames cultivées.
L'étude de ces plantes ennoblies, et d'autres faisant déjà partie de variétés cultivées, a permis aux chercheurs de démontrer que l'ennoblissement a pour résultat l'intégration dans les plantes cultivées d'ignames d'origines sauvage et hybride. Ceci est observé dans différentes régions écologiques et ethnolinguistiques.
Par cette démarche, les cultivateurs augmentent donc la diversité génétique des ignames cultivées, via le flux de gènes en provenance des ignames sauvages, non seulement avec de nouveaux allèlesallèles d'origine sauvage mais surtout avec de nouvelles combinaisons génétiques produites par la reproduction sexuée. Les cultivateurs bénéficient ainsi des avantages sur le long terme de la reproduction sexuée. Celle-ci préserve les capacités d'adaptation à des environnements différents et aux pressionspressions des cultivateurs. De même, l'asexualitéasexualité conserve les meilleurs génotypesgénotypes par multiplication végétative.
Même si l'ennoblissement n'est pratiqué que par moins de 5% d'agriculteurs au Bénin, son impact est accru par les échanges de semences au sein des réseaux sociauxréseaux sociaux. Il apparaît donc indispensable d'intégrer ces pratiques dans une stratégie de conservation in situ des ignames, qui devra prendre en compte les variétés cultivées et sauvages.