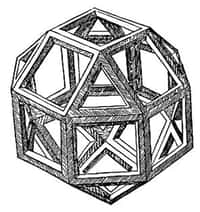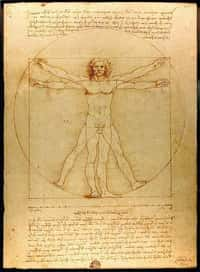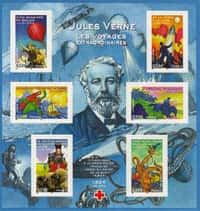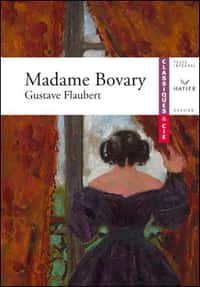au sommaire
Née à Paris en 1626 et morte à Grignan, dans la Drôme, le 17 avril 1696, Marie de Rabutin-Chantal est la petite-fille de Jeanne de Chantal, qui fonda l'ordre de la Visitation avec François de Sales.
Elle est élevée par son grand-père, puis, à la mort de ce dernier, ce sont ses deux oncles, l'abbé Philippe de la Tour de Coulanges et Christophe de Coulanges, qui lui donneront une instruction et une éducation exemplaires. Elle perd son père en 1627, puis sa mère en 1633.

Portrait de Marie de Rabutin-Chantal, plus connue sous le nom de Madame de Sévigné. © Phrood, DP
Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné
En 1644, elle épouse Henri de Sévigné. Ce dernier, léger et dépensier, lui donnera deux enfants : Françoise-Marguerite, en 1646, et un garçon, Charles, en 1648. En 1651, Henri meurt dans un duel. Veuve à 25 ans, elle décide de se consacrer à la vie mondaine et à l'éducation de ses enfants.
Le 27 janvier 1669, sa fille, Françoise-Marguerite, épouse le comte de Grignan. Ce dernier est nommé lieutenant-général en Provence par Louis XIV. Devant y résider, sa femme l'accompagne. C'est à cette circonstance que nous devons les Lettres de Madame de Sévigné. Mille cinq cents lettres seront adressées à sa fille, mais aussi à son fils Charles, à son cousin Bussy-Rabutin, à ses amis Madame de Pomponne, le cardinal de Retz, La Rochefoucauld, le philosophe Corbinelli, Madame de La Fayette, Madame Scarron. Leur première publication eut lieu en 1726. La marquise de Sévigné mourut le 17 avril 1696, à Grignan, où elle était venue soigner sa fille, gravement malade.
Madame de Sévigné à Paris
Madame de Sévigné reste une Parisienne. Son œuvre la situe : « Je trouve que la joie fait parler parisien ». Elle sera peu à Versailles ; restée à Paris sous la Fronde, pendant le siège de la capitale par les troupes royales, Madame de Sévigné, amie des Retz, des Fouquet, des jansénistes fut un peu suspecte aux yeuxyeux du pouvoir central.
Mais elle aime sa ville comme un spectacle vivant : elle visite les couvents, les promenades, les grandes maisons, les Tuileries, l'opéra, la comédie et même la populaire foire Saint-Germain. Son Marais natal est le Paris à la mode. Elle y occupa l'hôtel Carnavalet : « Une belle cour, un beau jardin, un beau quartier ».
Madame de Sévigné et la province
Demoiselle de Bourgogne, épouse d'un gentilhomme breton, belle-mère d'un seigneur provençal (lieutenant général du Roi en Provence), Madame de Sévigné fit de longs séjours en province, que ce soit dans les châteaux de Bourbilly et de Chazeu, en Bourgogne, ou dans le château des Rochers, près de Vitré, où elle menait une vie retirée, avec des visites à sa voisine, la princesse de Tarente, ou à Mademoiselle du Plessis.
Elle écrit : « Cette province est un bel exemple pour les autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne leur point dire d'injures et de ne point jeter de pierres dans leur jardin ». Elle considère les âmes de paysan comme étant « droites comme des sillons ». La Provence est pour elle une « gueuse parfumée » et Marseille l'enchante.

Château de Rochers-Sévigné, à Vitré. © Luna04, CC by-sa 3.0
La famille de la marquise de Sévigné
Veuve à 25 ans avec deux enfants, elle témoigne le 17 juin 1687 : « Je n'avais retenu de dates que l'année de ma naissance et celle de mon mariage ; mais sans augmenter le nombre, je m'en vais oublier celle où je suis née, et je mettrai à la place celle de mon veuvage, qui a été assez douce et assez heureuse, sans éclat et sans distinction ».
Dès lors, cette mère marquera une prédilection pour sa fille, ce qui fera sa célébrité. Son fils Charles est quant à lui « le compère : c'est plus un ami qu'un fils, une fois adulte ».
Biographie de Madame de Sévigné en quelques dates
Voici sa vie en dates, pour mieux comprendre son œuvre :
- 5 février 1626 : naissance place Royale, à Paris, de Marie de Rabutin-Chantal. Par son père, elle appartient à une très noble famille de Bourgogne.
- 1627 : mort du père, au siège de l'île de Ré.
- 1633 : mort de la mère, dont Madame de Sévigné ne parle jamais.
- 1637 : son oncle et sa tante, Philippe et Marie de Coulanges, sont ses tuteurs. Elle apprend le chantchant, la danse, l'équitation, les belles lettres, un peu de latin, d'espagnol et surtout l'italien.
- 1644 : mariage de Marie de Rabutin-Chantal et du baron Henri de Sévigné.
- 1646 : naissance à Paris de Françoise-Marguerite de Sévigné, future comtesse de Grignan.
- 1648 : naissance aux Rochers de Charles de Sévigné.
- 1651 : Henri de Sévigné se bat en duel pour sa maîtresse, Madame de Gondran. Il est tué.
- 1661 : véritable prise du pouvoir par Louis XIV. Arrestation de Fouquet, grand ami de Madame de Sévigné.
- 1664 : Fouquet est condamné à l'emprisonnement à vie.
- 1665 : publication de L'Histoire amoureuse des Gaules, où l'auteur, Bussy-Rabutin, fait un portrait cruel de sa cousine.
- 1669 : mariage à Paris de Françoise-Marguerite de Sévigné avec le comte de Grignan.
- 1670 : naissance à Paris de Marie-Blanche, fille de Madame de Grignan.
- 1671 : Madame de Grignan part rejoindre son époux. En novembre : naissance de Louis-Provence de Grignan.
- 1674-1675 : naissance de Pauline de Grignan. En Bretagne, insurrections et répression brutale.
- 1676 : Madame de Sévigné aux Rochers. Puis, Madame de Grignan retrouve sa mère à Paris. Elles sont ensemble jusqu'en 1679.
- 1679 : mort du cardinal de Retz, parent et ami de Madame de Sévigné. Madame de Grignan retourne en Provence.
- 1681-1684 : mère et fille ensemble à Paris. Mariage de Charles de Sévigné, en Bretagne, avec Marguerite de Mauron.
- 1685 : retrouvailles de la mère et de la fille.
- 1688 : Madame de Grignan revient en Provence.
- 1689 : Madame de Sévigné va rejoindre sa fille à Grignan. Elle séjourne en Provence jusqu'en 1691, date de son retour à Paris avec les Grignan.
- 1694 : retour de Madame de Grignan en Provence. C'est la dernière séparationséparation. Elle est rejointe par sa mère quelques mois plus tard.
- 1696 : mort de Madame de Sévigné au château de Grignan.
- 1725 : première édition des Lettres de Madame de Sévigné.
Œuvre de Madame de Sévigné : ses lettres
La correspondance avec sa fille s'effectua pendant trente ans, avec chaque semaine plusieurs lettres. Une première édition clandestine, en 1725, comprenait 28 lettres. Elle fut suivie de deux autres, en 1726 : Pauline de Simiane, petite-fille de l'intéressée, décida en effet de publier officiellement la correspondance de sa grand-mère, soit 614 lettres.
La question de l'authenticité des lettres se pose de manière cruciale. Sur les 1.120 connues, 15 % proviennent des autographes, lesquels ont été détruits. Néanmoins, en 1873, un lot de manuscrits a été retrouvé chez un antiquaire. Il couvre environ la moitié des lettres adressées à Madame de Grignan.
Citations
Voici quelques extraits :
- « Le cœur n'a pas de rides. »
- « La vie est pleine de choses qui blessent le cœur. »
- « Il n'y a rien de plus vrai que l'amitié qui se réchauffe quand on est dans les mêmes intérêts. »
- « La vie est courte ; c'est la consolation des misérables et la douleurdouleur des gens heureux ; et tout viendra au même but. »