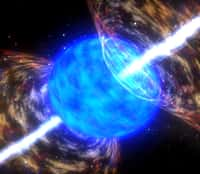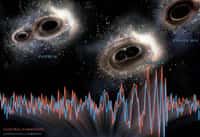au sommaire
Avant de plonger au cœur de l'étude des plantes de Guyane et de leur utilisation, faisons d'abord connaissance avec les peuples résidant sur ce territoire.
L'inventaire des plantes présumées antiparasitaires ne peut être séparé d'un inventaire global des pratiques médicinales à base de plantes auprès d'un groupe donné de population. Une étude générale des pratiques médico-religieuses est mieux comprise et acceptée par les informateurs.

Quels sont les peuples de Guyane française et du Suriname ? Quelles plantes utilisent-ils ? Ici, les fruits du Ceiba pentandra. © AmyLv, Shutterstock
La méthode occidentale de parcellisation de la connaissance ne fait pas partie de leur conception globalisante de la nature, le rapport de confiance est alors difficile à établir. Les résultats sont souvent erronés par le fait que le chercheur, sortant l'information de son contexte, la dénature.

Expression du manioc dans une couleuvre (vannerie) pour en retirer les toxines. Village de Banafokondre, pays Saramaka, Suriname (1984-1986). © IRD, Michel Sauvain, tous droits de reproduction interdits
Les Noirs Marrons du Suriname et de Guyane française
Il existe quatre groupes principaux de Noirs Marrons répartis essentiellement sur le territoire du Suriname avec une extension territoriale sur le Maroni, en Guyane française. Il s'agit :
- des Saramaka ;
- des Ndjuka ;
- des Boni, ou Aluku ;
- des Paramaka.
L'habitat de ces populations est la forêt tropicaleforêt tropicale humide. Ces groupes colonisent les bords des rivières de l'intérieur, voies de pénétration dans la forêt et ont un mode de vie où l'eau et la forêt jouent des rôles déterminants. La constitution de leurs groupes remonte au XVIIe siècle : la fuite des esclaves d'origine africaine des plantations de l'ex-Guyane hollandaise, le Suriname actuel, en est la première étape.

Une abondance de plantes médicinales, riches en molécules nouvelles… Encore faut-il savoir lesquelles récolter : l'ethnopharmacologie peut donner des pistes. © IRD, Geneviève Bourdy, tous droits de reproduction interdits
Pendant les premiers temps de leur vie dans la forêt, ils ont été soumis à la pression d'une longue guérilla avec les colons hollandais et leurs mercenaires anglais. Leur genèse s'achève au XVIIIe siècle avec le passage du dernier groupe constitué en Guyane française, les Boni, ou Aluku, chassés à la fois par les Hollandais et les Ndjuka. La constitution récente de ces groupes (moins de trois siècles pour le plus vieux) autorise à penser que leurs connaissances du monde végétal ont des origines variées avec des emprunts nombreux.