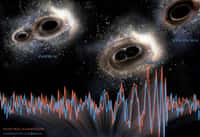au sommaire
Il existe plusieurs modes de traitement des droguesdrogues végétales (terme n'impliquant pas forcément la notion d'addictionaddiction mais désignant une partie végétale utilisée en thérapeutique) chez les Saramaka.
Les organes les plus utilisés par les Saramaka sont les parties feuillées des arbustes, les écorces de troncs des grands arbres, la plante entière dans le cas de plantes de petites tailles (épiphytes, herbacées), les racines plus rarement ; la difficulté de l'extraction de ces dernières et leurs formes leur donnent souvent des pouvoirs en rapport avec la force, la virilité. La facilité d'approvisionnement oriente aussi le choix des récolteurs.

Drogues végétales : quels sont les modes de traitements (macération, décoction…) ? Ici, Annona squamosa. © Lotus Images, Shutterstock
Les modes les plus fréquents de traitements des drogues végétales sont les suivants.

En Guyane, des traitements préventifs contre le paludisme sont utilisés par les personnes vivant en zone d'endémie. On boit ainsi traditionnellement des « amers », c'est-à-dire des plantes macérées à froid dans le rhum (ou dans un autre alcool) dans ce but. Ces plantes mises à macérer sont très amères, et elles sont censées communiquer leur amertume au corps et le protéger. © IRD, Geneviève Bourdy, tous droits de reproduction interdits
Macérations et décoctions

Préparation d'un remède tonique sous forme d'une décoction, pris en bain, préparé par Stephan Galimo, tradipraticien. Village de Banafokondre, pays Saramaka, Suriname. © IRD, Michel Sauvain, tous droits de reproduction interdits
- Les macérationsmacérations dans l'eau et le rhum ;
- Les décoctions ;

Traitement des suites d'un accouchement à base de l'expression de sucs végétaux qui sont ensuite inhalés. Village de Banafokondre, pays Saramaka, Suriname. © IRD, Michel Sauvain, tous droits de reproduction interdits
- la récupération de la sève par pressage, du latex par lavage, de l'écorce par grattage ou broyage ;

Préparation d'un remède tonique sous forme d'une décoction, pris en bain, préparé par Zenpen, tradipraticien et « capitaine » (maire) du village de Banafokondre, pays Saramaka, Suriname. © IRD, Michel Sauvain, tous droits de reproduction interdits
- Le mode le plus usuel est le bain (washi ; 31 %)), qui doit être considéré plus comme une ablution que comme un véritable bain dans le sens européen. Ce bain s'additionne en général d'une prise orale réduite de l'eau de la décoction ou de la macération. C'est la préparation principale pour les problèmes dermatologiques, les fièvresfièvres, les refroidissements et aussi pour les usages rituels. Ce type d'administration semble généralisé dans les populations sylvicoles.
Voie orale, bains de vapeur…
- la voie orale (dingi ; 31 %) qui sert essentiellement dans les désordres de type digestif (diarrhéesdiarrhées, vers...) ;
- les cataplasmescataplasmes et onguents en complément des bains pour les problèmes liés à la peau ;
- les voies nasale et oculaire pour les désordres liés à la tête et la vision ;
- les bains de vapeur de plantes odorantes, intermédiaires entre le bain et la prise nasale, surtout pour les refroidissements et les fièvres.