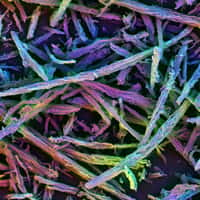au sommaire
Grâce à la génomique, les scientifiques sont parvenus à pénétrer la séquence génétique complète de plus de 300 espèces bactériennes. Aujourd'hui, pour la fabrication d'un vaccin, les chercheurs s'appuient donc sur la connaissance du génome du micro-organisme pour repérer les gènes susceptibles d'être utilisés. Cette démarche scientifique relève d'une discipline récente, la vaccinologie inverse.
La vaccinologie inverse identifie des gènes exploitables
Une fois identifiés, les gènes « exploitables » peuvent être combinés entre eux, puis introduits dans un organisme capable de se multiplier rapidement - une levurelevure par exemple -, afin de produire des candidats antigènes. Ces derniers seront ensuite triés en fonction de leur aptitude à susciter des réponses immunitairesréponses immunitaires protectrices. C'est ce que l'on appelle le pouvoir immunogène.
Vaccinologie inverse : une autre façon de chercher les antigènes
Voilà pourquoi cette méthode porteporte le nom de « vaccinologie inverse » : à partir du plan d'organisation génétique du micro-organisme, elle « remonte » en effet la chaîne biologique pour aboutir aux antigènesantigènes recherchés.
A contrario, la méthode classique d'élaboration de vaccin consiste à partir du micro-organisme pathogènepathogène lui-même, cultivé en laboratoire pour obtenir un nombre restreint d'antigènes. Le processus est alors beaucoup plus long, car les antigènes obtenus doivent ensuite être soumis à des tests pour déterminer leur pouvoir immunigène.