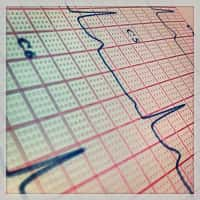au sommaire
Notre série d'articles sur la guerre d'Algérie
- 1er sujet : Qu'est-ce que le traumatisme psychologique ?
- 2e sujet : Témoignage d'un ancien appelé devenu psychologue
La résilience pour surmonter le psychotraumatisme
Comme nous l'avons vu, la guerre d'Algérie qui a pris fin il y a cinquante ans a laissé des stigmates psychologiques. Comment fait-on pour retrouver une vie normale et dépasser son traumatisme ? Boris Cyrulnik, psychiatre et éthologue français, très connu pour avoir apporté et développé en France le concept de résiliencerésilience, a lui-même dû surmonter la souffrance psychologique quand il a échappé de peu à la Shoah alors qu'il n'était qu'un enfant, contrairement à sa famille déportée dans les camps. Il a répondu à Futura-Sciences sur les solutions qui peuvent être mises en place pour s'en sortir.
Futura-Sciences : En tant que psychiatre, vous avez rencontré des anciens combattants d'Algérie qui demandaient des soins. Y a-t-il une spécificité de leur traumatisme ?
Boris Cyrulnik : Non, je ne crois pas qu'il y ait eu une particularité des syndromes psychotraumatiques lors de ce conflit armé. En général, les troubles constatés chez les soldats qui rentrent à la maison sont assez identiques. Malgré tout, à la différence des guerres plus récentes, le silence qui a pesé sur ces acteurs à leur retour n'a en rien arrangé les choses. Certains vétérans d'Indochine et d'Algérie ont eu besoin d'une psychanalyse, il a fallu recréer des conditions de paroles. Mais cela ne concerne pas tous les soldats.
Comment alors surmonter ce traumatisme psychologique ?
Boris Cyrulnik : Il faut d'abord savoir que les traumatismes n'apparaissent pas toujours chez les militaires qui vont au feufeu. Pour le conflit actuel en Afghanistan, les soldats qui restent au camp, ceux qui sont harcelés par des tirs de roquettes et qui se trouvent privés de leur vie normale (nuits perturbées, quotidien bouleversé, etc.)) sont dépossédés de leur monde intime. Ils s'imaginent la guerre, leurs camarades en opération sous la mitraille ennemie. Et c'est parmi eux que l'on retrouve le plus de psychotraumatismes : ils ne pensent qu'à ça, n’en dorment pas la nuit, revoient les images d'horreur. Ils plongent dans la dépression, l'angoisse et l'hébétude.
Pour s'en remettre, il y a deux aspects fondamentaux : se sentir soutenu et donner sens à ce qui se produit. Avant même les combats, les soldats vivant au sein d'une famille stable et fiable vont savoir trouver le soutien en amont, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux qui n'ont qu'un attachement chancelant avec leurs proches. Ils se retrouvent seuls et développent davantage de psychotraumatismes. Pendant le combat, ce n'est pas là où il y a le plus de dégâts psychologiques. Et lorsque les coups de feu ont cessé, la prise en charge a nettement évolué. Les Américains par exemple n'envoient plus maintenant un homme seul au combat, il est toujours épaulé par un compagnon qui lui donne des conseils, l'invitant à parler, à exprimer toutes ses questions sur la mort, pour instaurer une confiance. Le groupe tout entier doit aussi se souder, et reconnaître que chacun peut avoir été perturbé par les événements qu'il vient de vivre. Cela tranche nettement avec les méthodes pratiquées durant la guerre de Corée (1950-1953), où on giflait les soldats qui tremblaient et on les qualifiait de lâches.

Depuis la guerre du Viêt Nam (1964-1975), la prise en charge psychologique des vétérans de guerre s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, les militaires américains engagés en Afghanistan sont mieux formés et toujours suivis d'un compagnon, qu'ils appellent le guy, pour éviter la terrible solitude et favoriser l'expression. © isafmedia, Fotopédia, cc by 2.0
Le soutien permet l'expression. Si l'on est entouré de personnes en qui on n'a pas confiance, on se taira. Le silence est en fait l'adaptation à l'hostilité des gens qui nous entourent. Lorsque les survivants de la Shoah sont revenus, ils parlaient. Mais la culture les a fait taire, et même parfois leur propre famille. Il en a été de même pour les vétérans de l'Algérie.
Et le sens alors ?
Boris Cyrulnik : Lorsqu'on arrive à donner sens au combat, les risques de développer un syndrome psychotraumatique sont moindres. Ce sens dépend beaucoup de notre famille, de notre éducation, et donc de notre culture. Et cette guerre d'Algérie n'a pas toujours été bien comprise par les soldats français, engagés parfois bien malgré eux dans ce conflit, en fait des civils auxquels on a donné une arme en leur demandant de s'en servir. Lors du référendum de janvier 1961, trois Français sur quatre ont voté pour l'autodétermination de l'Algérie. Comment s'investir dans un conflit qu'on n'approuve pas ?
Désormais, la prise en charge du traumatisme de guerre a donc bien évolué ?
Boris Cyrulnik : La résilience, ce concept qui consiste à renaître de sa souffrance, à reprendre un développement, parfois très bon, parfois bon, fait maintenant partie de la formation de tous les soldats. Mais on ne se limite pas à cela. On prépare également les familles de ces combattants, de manière à ce qu'elles ne fassent pas taire le vétéran à son retour, et qu'elles le plongent dans une atmosphèreatmosphère sécurisante. Bien heureusement, la majorité des soldats ne souffre pas de psychotraumatisme. Mais en déployant tous ces efforts, on limite encore davantage le nombre des victimes.