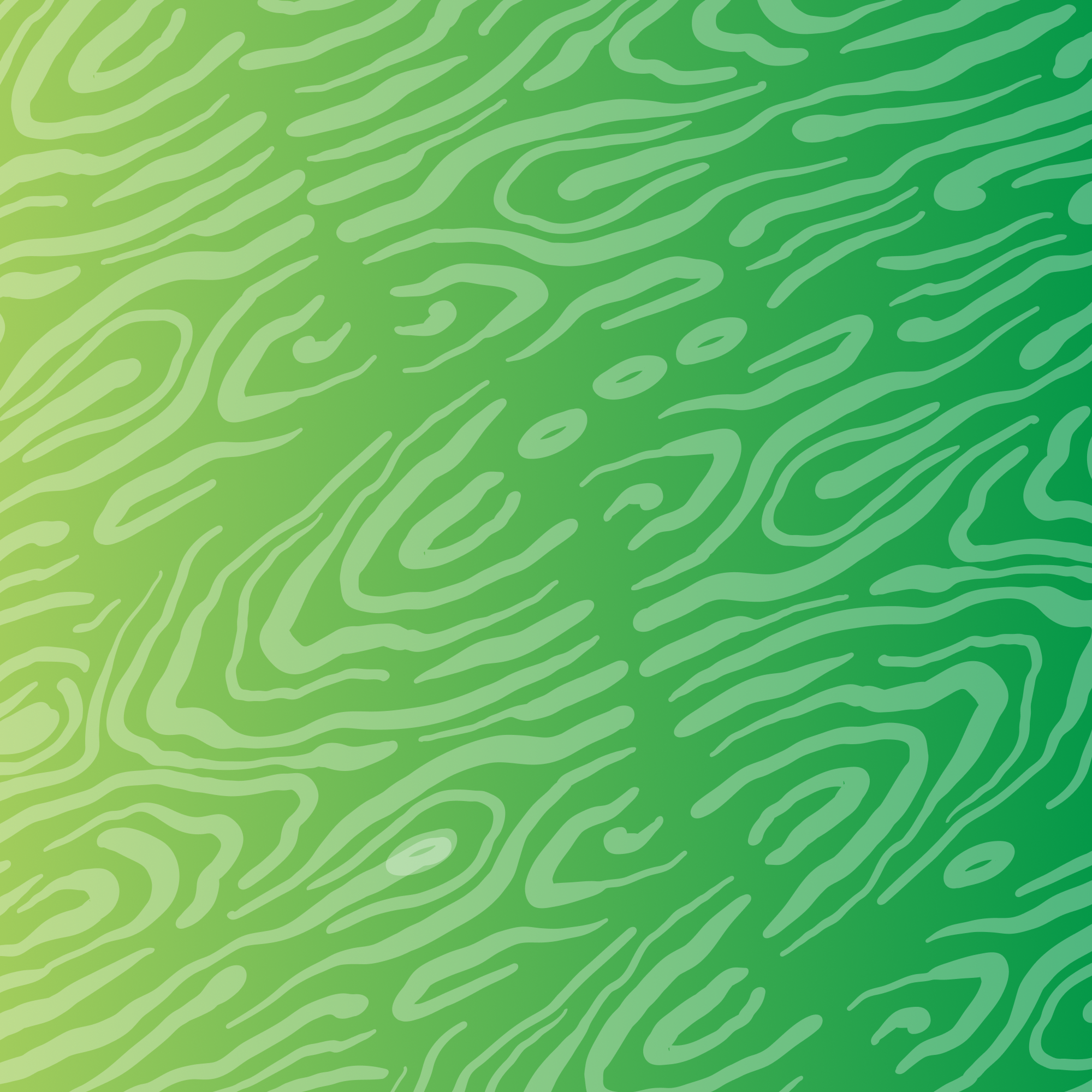“
Chercheur dans le domaine de l'évolution du climat, je suis très attaché à ce que les connaissances nouvelles auxquelles nous accédons à travers les travaux de recherche conduits par notre communauté scientifique soient facilement accessibles au plus grand nombre. J'apprécie et soutiens la contribution importante de Futura-Sciences à cet objectif.
“
Découvrez sa
Biographie
Jean Jouzel est né le 5 mars 1947 à Janzé, en Bretagne. Son parcours académique commence du côté de la chimiechimie avec l'obtention d'une licence en 1967.
En 1968, il est diplômé de l'école supérieure de chimie industrielle de Lyon et poursuit avec un DEA de chimie physiquephysique à l'issue duquel il présente sa thèse. En 1974, sa thèse de docteur ès-sciences, effectuée au sein du CEA (Commissariat à l'énergieénergie atomique et aux énergies alternatives), porteporte sur les mécanismes de formation des grêlons.
C'est au même CEA que sa carrière de scientifique commence. Il doit son premier succès au projet Vostok qui voit la découverte d'une couche de glace de 200 mètres sous le lac sous-glaciaire du même nom, en AntarctiqueAntarctique.
Fort de ce succès et de celui du programme Grip (forage au Groenland), Jean Jouzel met sur pied le programme Epica qui consiste à effectuer des forages dans l'Antarctique, et en devient directeur de 1995 à 2001.
Parallèlement, il assure les fonctions diverses de responsable du laboratoire de géochimie isotipique du CEA de 1986 à 1991, directeur adjoint du laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement (CNRS) de 1989 à 1995, directeur adjoint du laboratoire de modélisationmodélisation du climatclimat et de l'environnement (CEA) de 1991 à 1996, chef de ce même laboratoire en 1997 ou encore responsable du groupe « climat » au sein du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CEA/CNRS).
De 2001 à 2008, il est directeur de l'institut Pierre-Simon LaplacePierre-Simon Laplace, une fédération de sept laboratoires créée en 1991, travaillant notamment sur les questions du climat. Depuis 1995, il est directeur de recherches au CEA.
En 1994, Jean Jouzel intègre le GiecGiec (Groupe d'experts international sur l'évolution du climat), en tant qu'expert du groupe de travail n°1. Il fait maintenant partie du conseil d'administration du groupe d'experts.
En 2002, le CNRS lui décerne, conjointement avec Claude Lorius, sa médaille d'or, plus haute distinction de la recherche scientifique en France. En 2007, avec le Giec, il reçoit le prix Nobel de la paix.
Jean Jouzel est également membre de nombreuses académies ou sociétés savantes.
Au cours de sa carrière, il a été l'auteur de plus de 250 publications scientifiques dont environ 200 sont parues dans les meilleures revues scientifiques (revues de rang A, comme Nature ou Science). Il est l'un des auteurs les plus cités dans le domaine des sciences de l'universunivers.
Jean Jouzel : mes activités scientifiques
Mes travaux de recherche concernent, pour l'essentiel, l'utilisation des formes isotopiques de la moléculemolécule d'eau en vue de reconstruire les changements climatiques passés à partir des glaces polaires et la modélisation isotopique associée aussi bien à partir de modèles simples que de modèles de circulation générale de l'atmosphèreatmosphère (MCG). Depuis les années 70, j'ai activement participé à presque tous les grands programmes internationaux basés sur l'étude de forages glaciaires et au développement de la modélisation des isotopesisotopes de l'eau dans l'atmosphère avec, sur le plan international, un leadership reconnu dans ces deux domaines.
Après l'obtention d'un diplôme d'ingénieur chimiste, je me suis formé à la géochimie isotopique durant ma thèse préparée à Saclay et consacrée à l'étude de la formation de gros grêlons à partir de la répartition des isotopes de l'eau, HDO (deutérium), H218O (oxygène 18) et HTO (tritium). Cette thèse m'a familiarisé avec les différents aspects des fractionnements isotopiques qui affectent les molécules d'eau, ce qui m'a ensuite été fort utile pour aborder la modélisation de ces isotopes dans l'atmosphère et dans les précipitationsprécipitations à l'échelle globale. À l'issue de cette thèse, j'ai accompli l'ensemble de mes travaux de recherche comme ingénieur puis directeur de recherche au CEA, au sein d'un laboratoire dépendant de cet organisme (LGI), puis d'une UMR (LMCE puisLSCE, Unité mixte CEA-CNRS-UVSQ).
Le développement d'un modèle simple d'un point de vue dynamique (type modèle de Rayleigh) mais prenant en compte la complexité des processus de fractionnement liés à la différence des pressionspressions de vapeur saturante (fractionnement à l'équilibre) et des diffusivités moléculaires (effet cinétique) a constitué une première contribution importante. J'ai ensuite étendu les modèles initialement développés dans les années 60 de façon à tenir compte des fractionnements cinétiques à la surface de l'océan et lors de la formation de la neige. Cette approche qui s'appuie sur une description détaillée de la physique des isotopes a également été appliquée aux systèmes convectifs et aux nuagesnuages mixtes. Les formulations que j'ai alors développées avec Liliane Merlivat et Philippe Ciais sont, depuis, très largement utilisées, y compris dans le cadre du développement de MCG incluant les molécules isotopiques.
À la fin des années 70, j'ai été à l'origine de cette approche novatrice consistant à introduire les isotopes de l'eau dans un modèle de circulation générale de l'atmosphère. Le premier MCG doté d'une version isotopique (IMCG) a été celui du Laboratoire de MétéorologieMétéorologie Dynamique (thèse de Sylvie Joussaume). En collaboration avec Randy Koster, j'ai ensuite introduit les isotopes de l'eau dans le modèle du GISS (New-York), institut de la NASANASA où j'ai séjourné pendant deux ans. Avec ce modèle, j'ai réalisé des simulations aussi bien pour le climat moderne que pour celui du dernier maximum glaciaire et exploré le lien entre l'origine des précipitations et leur teneurs isotopiques. J'ai également collaboré de façon étroite avec Georg Hoffmann (modèle isotopique ECHAM) et été associé au développement de la nouvelle version isotopique du modèle du LMD.
C'est avec l'objectif d'améliorer l'interprétation climatique des profils isotopiques enregistrés dans les glaces polaires que je me suis impliqué dans cet effort de modélisation s'appuyant à la fois sur des modèles simples et sur des IMCG. Cette approche a permis d'examiner la validité du paléothermomètre isotopique basé sur l'utilisation des données observées dans les conditions actuelles pour interpréter les données du passé. Combinant modèles simples etIMCG, j'ai contribué à expliquer pourquoi cette approche est justifiée en Antarctique alors qu'elle ne l'est pas au Groenland. Cette modélisation a également permis d'établir un lien entre l'excès en deutérium (une combinaison linéaire des teneurs en deutérium et oxygène 18) et les conditions (température,humidité relative,...) prévalant dans les régions océaniques d'où proviennent ces précipitations.
Des fractionnements prennent également place lorsque l'eau gèle et là aussi, j'ai largement contribué, en collaboration avec Roland Souchez, à l'utilisation de cette propriété afin d'étudier la formation de la glace dans différents contextes (glaciersglaciers tempérés et polaires, glace de mer, glace de regel...). Elle a ainsi permis de caractériser la glace qui, sur une épaisseur de plus de 200 m, s'est accrétée par regel à la base de la calotte antarctique à partir de l'eau du Lac Vostok (lac sous-glaciaire).
J'ai commencé à étudier les glaces polaires dans les années 70, en collaboration avec Claude Lorius et ses collègues grenoblois, en participant à l'étude isotopique du premier forage Dome C réalisé en 1977. Je me suis ensuite pleinement consacré au projet Vostok conduit dans les années 80 et 90 avec des équipes russes et américaines, en apportant une contribution clé à l'obtention des séries climatiques. C'est largement grâce aux résultats obtenus sur ce carottagecarottage permettant de reconstruire climat et environnement - en particulier gaz à effet de serregaz à effet de serre - sur plus de 400 000 ans que Claude Lorius et moi-même avons conjointement reçu la Médaille d'or du CNRS en 2002. Mon nom est également associé à la mise sur pied et au succès du projet européen EPICA (European project for Ice Coring in Antarctica dont j'ai assuré la responsabilité de 1994 à 2000). Il s'est concrétisé par deux forages en Antarctique de l'Est dont l'un a permis d'étendre l'échelle de temps à 800 000 ans (Dome C) tandis que l'accumulation plus élevée à EDML (secteur atlantique) nous a offert l'opportunité d'examiner de façon optimale les relations de phase entre le climat du Groenland et celui de l'Antarctique.
Au-delà de l'analyse et de l'interprétation des profils isotopiques, j'ai fortement contribué à de nombreux autres aspects des projets Vostok et EPICA : établissement des chronologies, comparaison entre les variations climatiques et celles des gaz à effet de serre, corrélation avec d'autre enregistrements paléoclimatiques, contribution à l'interprétation de divers paramètres enregistrés dans ces glaces incluant les teneurs en poussière et en bérylliumbéryllium 10 ainsi que les teneurs isotopiques de l'oxygène de l'airair, de l'azoteazote, de l'argonargon et du soufresoufre. Ces travaux ont été réalisés avec Valérie Masson - Delmotte, ma plus proche collaboratrice à Saclay depuis une quinzaine d'années, avec de brillants étudiants en thèse (cf liste) dont presque tous ont intégré le monde de la recherche, et avec de nombreux collègues français (en particulier du Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement où j'ai été associé à l'équipe de direction de 1989 à 1995), et étrangers (européens, américains, argentins, australiens, chinois, japonais et russes). Notre contribution inclut également la démonstration - avec un article pionnier au début des années 80 - de l'intérêt de l'excès en deutérium comme outil permettant de mieux comprendre le fonctionnement du cycle de l'eau dans les régions polaires. De fait, en réponse à ces travaux, le deutérium et l'oxygène 18, sont depuis systématiquement analysés sur les tous les carottages glaciaires.
Quoique plus directement impliqué sur les projets conduits en Antarctique, j'ai aussi significativement contribué à ceux, GRIP et North GRIP, conduits au Groenland, en mettant l'accent sur l'étude des relations interhémisphériques.
En résumé, j'ai depuis environ 35 ans été un acteur de premier plan de presque tous les programmes de forages profonds réalisés en Antarctique ou au Groenland (ceci incluant des collaborations avec les scientifiques américains du projet GISP 2 au Groenland). J'ai eu la responsabilité de l'équipe "glaces" de notre laboratoire de Saclay jusqu'au milieu des années 1990, une responsabilité prise en charge, depuis, par Valérie Masson - Delmotte. Je suis toujours impliqué dans les activités de cette équipe qui travaille actuellement sur l'interprétation des données obtenues dans le cadre du projet EPICA et sur des projets en cours au Groenland (NEEM) et en Antarctique (Talos Dome).
En dehors de la communauté intéressée par les carottages glaciaires, j'ai établi des liens étroits avec les paléocéanographes avec l'objectif d'utiliser de façon optimale les enregistrements glaciaires pour déchiffrer les mécanismes à l'oeuvre aussi bien à l'échelle de temps des grands cycles climatiques qu'à celle des variations climatiques rapides. J'ai appliqué la même approche pour les enregistrements continentaux en développant des collaborations avec des spécialistes des sédimentssédiments lacustreslacustres et des enregistrements obtenus à partir de stalagmitesstalagmites. Outre ma forte contribution au développement de la modélisation isotopique, j'ai été à l'origine du lancement du projet d'intercomparaison des MCG pour des simulations de climats passés (projet PMIP).
J'ai également contribué à des projets visant à reconstruire les variations climatiques récentes (le dernier millénaire) et me suis beaucoup intéressé à ce en quoi l'étude des climats passés est pertinente pour mieux cerner son évolution future. Dans ce contexte, je peux citer ma participation aux travaux duGIEC, pratiquement dès son origine, comme auteur principal des 2e et 3e rapports et depuis 2001 comme membre de son bureau (vice-président du groupe scientifique). Je citerai également mon implication, au titre de la coordination française, dans un consortium européen engagé depuis cette année dans un projet de l'Institut Européen de Technologie largement dédié à l'innovation dans le domaine de la lutte contre l'effet de serre et de l'adaptation au réchauffement climatiqueréchauffement climatique.
Je suis auteur ou coauteur d'environ 400 publications, la plupart dans des revues à comité de lecture. Ceci inclut 48 publications dans les revues Nature ou Science et de nombreux articles dans des journaux de tout premier plan. La moitié d'entre elles concerne les glaces polaires (climat du quaternairequaternaire et changements climatiques rapides) tandis qu'environ 40 % sont liées aux isotopes dans les précipitations et à la modélisation associée (incluant les aspects touchant à l'excès en deutérium) ; les autres traitent du lien entre climat passé et climat futur. Ces publications sont très bien citées. Le nombre total de citations est proche de 25.000 (Facteur H de 73) avec un accroissement significatif au cours des toutes dernières années (~ 8.000 citations sur la période 2007-2011), mettant, je crois, en exergue l'importance des travaux basés sur l'analyse des glaces polaires.
La qualité de mes travaux a été pleinement reconnue aussi bien sur le plan national (Médaille d'Or du CNRS conjointement avec Claude Lorius) qu'international (Médaille Milankovitch de l'EGS et Médaille Revelle de l'EGU, Prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco). Conjointement avec Susan Solomon, j'ai reçu le prix 2012 de la Fondation Vetlesen ; cette récompense décernée tous les 4 à 5 ans est considérée - c'est également le cas du Prix Craaford - comme le « Nobel des Sciences de la TerreTerre et de l'Univers ».
En parallèle à mes activités de recherche, j'ai consacré une partie de mon temps au service de notre communauté en acceptant de prendre des responsabilités de direction et en m'investissant dans différentes initiatives ou organisations scientifiques aux plans national et international. En charge du Laboratoire de Géochimie Isotopique à partir de 1986, ces responsabilités ont, de 2001 à 2008, culminé avec la direction de l'IPSL, un institut qui fédère six laboratoires de la région parisienne dont les recherches concernent le climat et l'environnement (y compris planétaire).
J'ai par ailleurs présidé de nombreux comités au niveau national. Président jusqu'à fin 2009 du Conseil d'Administration de l'Institut Polaire Paul-Emile Victor (IPEV) et du Comité Scientifique Consultatif de Météo-France (COMSI), je préside actuellement le Haut Conseil de la Science et de la Technologie (HCST), placé auprès du Premier ministre. Mes activités internationales concernent ou ont concerné le GIEC, la Fondation Européenne de la Science, le Programme Recherche Mondial sur le Climat, le Programme International BiosphèreBiosphère Géosphère et le Conseil Européen de la Science. Je suis également actif en dehors du monde de la recherche (cf CV). Enfin je consacre une partie notable de mon temps à la communication vers le grand public et à la rédaction d'ouvrages s'intéressant à l'évolution passée et future de notre climat.
Découvrez son
métier
Quels sont les objectifs du GIEC, comment s’est-il mis en place, comment fonctionne-t-il, quelles sont les conclusions les plus importantes de ses rapports successifs, et ses relations avec le décideurs politiques ? Autant de questions sur lesquelles je vais essayer d’apporter le témoignage d’un chercheur qui y a consacré une partie notable de son temps, comme auteur principal des 2e et 3e rapports, entre 1993 à 2001, puis comme membre du bureau, et à ce titre vice-président de son groupe scientifique, depuis 2002.
Les scientifiques donnent l’alerte
Dès la fin XIXe siècle, le suédois Svante Arrhénius attirait l’attention sur le réchauffement lié aux rejets de gaz carbonique liés à l’utilisation du charbon. Mais ce n’est qu’à partir des années 1970 que le problème de l’action potentielle des activités humaines sur le climat commence à préoccuper les scientifiques. D'abord les modélisateurs qui, depuis une vingtaine d'années, bénéficient de l’apparition des premiers calculateurs et s’intéressent très vite à la capacité de modèles, initialement développés pour prédire le temps, à rendre compte de climats différents de celui dans lequel nous vivons actuellement.
Ces modèles climatiques confirment qu’un doublement de la teneur en dioxyde de carbone (CO2 communément appelé gaz carbonique) se traduirait par un réchauffement important compris entre 1,5 et 4,5 °C suivant le modèle considéré. Une large partie de la communauté scientifique est alors convaincue de l’ampleur du problème et de la nécessité d’en analyser toutes les facettes. Les résultats publiés en 1987 à partir de l'analyse des glaces antarctiques de Vostok participent à cette prise de conscience. Ils montrent que, dans le passé, CO2 et climat ont varié de concert. Ainsi, les concentrations de CO2 étaient de 50 % plus élevées au cours de la période chaude qui, depuis environ 10.000 ans, a favorisé le développement de nos civilisations, qu'au moment du dernier maximum glaciaire, il y a 20000 ans.
La communauté scientifique internationale s’organise rapidement. Dès 1979, l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) met sur les rails le Programme de Recherche Mondial sur le Climat suivi par d’autres initiatives qui vont permettre d’amplifier les recherches sur l’évolution passée et future de notre climat. Les modèles sont alors assez rudimentaires et les conséquences d’un réchauffement climatique encore mal cernées, mais les politiques ne tardent pas à emboîter le pas. Les scientifiques les ont rapidement convaincus de la nécessité d’établir un diagnostic vis à vis du rôle potentiel des activités humaines sur le climat. C'est l'objectif, qu'à l’initiative du G7 dont sont alors membres Margaret Thatcher et George Bush, ils assigneront au GIEC créé en 1988 sous les auspices conjoints de deux organisations dépendant de l'ONU, le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et l’OMM. La mise sur pied du GIEC doit aussi beaucoup à des scientifiques de renom tel que le suédois Bert Bolin qui en sera le premier président.
Du premier rapport du GIEC à la Convention Climat
La mission assignée au GIEC est de préparer un rapport sur les connaissances scientifiques dans le domaine changement climatique, sur son impact social et économique et sur les stratégies possibles d’intervention, ainsi que de faire des recommandations sur une éventuelle convention internationale sur le climat.
Pour répondre à cet objectif, le GIEC s’intéresse à trois volets distincts : le groupe I traite des aspects scientifiques de l'évolution du climat, les deux autres étant respectivement en charge d'en examiner les impacts et d'analyser les mesures d'adaptation et d'évaluation (groupe II) et d'en étudier les aspects socio-économiques (groupe III). Publié en 1990, le premier rapport confirme que les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de l’effet de serre, à travers l’accroissement des concentrations atmosphériques de CO2 et d’autres gaz à effet de serre tels le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et différents composés chloroflorocarbonés, et par là même d’une accumulation de chaleur à la surface de la Planète. Il précise que la quantité de vapeur d’eau, principal gaz à effet de serre, va également s’accroître dans l’atmosphère et amplifier ce réchauffement. Si aucune mesure n'était prise, le climat moyen risquerait de se réchauffer à un rythme, jamais atteint, de 0,3 °C par décennie soit environ 3 °C d'ici la fin du XXIe siècle et le niveau de la mer de s’élever de façon significative (entre 20 et 65 cm).
L'alerte est clairement exprimée et dès décembre 1989 l’ONU demande aux gouvernements de mettre sur pied une Convention sur le Changement Climatique. Celle-ci sera adoptée le 9 mai 1992 et recevra la signature de 154 pays, dont les États-Unis, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro au cours duquel se concrétise la mise sur pied de deux autres conventions dédiées à la biodiversité et à la lutte contre la désertification. À travers son article 2, la Convention Climat se fixe l'objectif ultime de « stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai convenable pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable ». C’est un véritable défi car stabiliser l’effet de serre requiert, quelque soit le niveau visé, de diminuer les émissions de composés produits, pour une large part, par l’utilisation des combustiles fossiles (CO2) et par les pratiques agricoles (CH4 et N2O)
La première COP (Conference of Parties) qui rassemble tous les pays signataires de la Convention, se réunit à Berlin en 1995. Deux ans plus tard, à Kyoto, la COP 3 aboutit à la signature d’un premier protocole visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays développés (dits de l’annexe I dans le jargon du GIEC) de 5 % sur la période 2008-2012 par rapport à 1990 prise comme année de référence. Force est de constater que les décideurs politiques sont allés de l’avant. Moins de 10 ans se sont écoulés entre la création du GIEC et la signature d’un protocole de réduction. Mais la mise en œuvre ne sera pas à la hauteur de l’ambition, en particulier parce que ce protocole n’est pas ratifié par les Etats-Unis alors premier pays émetteur.
La mission du GIEC est précisée en 1998 : évaluer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation. La structure en trois groupes de travail, dont les contours vont légèrement se modifier d’un rapport à l’autre, est confirmée. Il est rappelé que les évaluations sont principalement fondées sur les publications scientifiques et techniques dont la valeur scientifique est largement reconnue, et que le GIEC n’a pour mandat ni d’entreprendre des travaux de recherche, ni de faire des recommandations aux décideurs politiques. Les rapports du GIEC doivent être policy relevant et non policy prescriptive.
Dit autrement, un des objectifs du GIEC est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu’ils puissent prendre des décisions ; certes, le GIEC peut-être appelé à rendre des avis scientifiques, techniques ou socio-économiques sur demande de la Convention Climat mais c’est au sein de celle-ci que sont prises ou non des décisions
Le fonctionnement du GIEC : la force d’une expertise collective
Les rapports du GIEC sont publiés à intervalles de 5 à 6 ans, 1990, 1995, 2001, 2007, puis 2013/2014 pour le 5e rapport. Le bureau, chargé d’en prendre la responsabilité, est renouvelé au début de chaque cycle ; il compte actuellement 30 membres issus, sauf exception, de pays différents. Il est composé d’un président par intérim (le soudanais Ismaël El Gizouli élu suite à la démission de Rajendra Pachauri visé par une plainte pour harcèlement sexuel) et de vice-présidents. Les autres membres sont répartis dans les trois bureaux de groupe et dans une équipe dédiée aux inventaires des gaz à effet de serre. Les rapports, volumineux, de chacun des trois groupes sont complétés par un résumé technique plus synthétique et par un résumé pour décideurs assez court. S’y ajoutent des rapports spéciaux portant sur des thèmes ciblés et des rapports techniques.
Une brève description des différentes étapes de la rédaction d’un rapport illustre l’esprit d’ouverture, de débat et de transparence qui en est la marque. Je m’appuie ici sur le rapport du groupe scientifique dans lequel je suis impliqué mais la procédure est similaire pour les autres groupes. Chaque chapitre est rédigé par une douzaine d’auteurs sous la responsabilité de deux d’entre eux. Le bureau du groupe est en charge de la sélection des auteurs choisis parmi ceux qui ont fait acte de candidature, environ un millier pour un peu plus de 200 auteurs. Le premier critère est celui de la qualité scientifique mais des critères de répartition géographique, de genre et de renouvellement sont également pris en compte. La rédaction est organisée autour de quatre rendez-vous espacés de 6 à 8 mois, entre lesquels les auteurs interagissent et font, s’ils le souhaitent, appel à des contributeurs.
Pour y avoir participé, je peux témoigner que ce processus de rédaction est un véritable lieu de débat. Par ailleurs, la version rédigée à l’issue du deuxième rendez-vous est ouverte aux commentaires de tout scientifique extérieur souhaitant apporter son avis, commentaires auxquels les auteurs doivent ensuite apporter une réponse. Des « éditeurs » dont le rôle se limite à vérifier que ce processus se déroule correctement se joignent alors à l’équipe d’auteurs. La version suivante est l’objet d’une seconde étape de commentaires qui transitent par les représentants des gouvernements et sont pris en compte dans la version finale des différents chapitres. La transparence du processus est assurée par la mise à disposition, après adoption du rapport définitif, des versions successives, des commentaires et des réponses qui y ont été apportées, et du rapport des éditeurs. Evidemment tous les commentaires sont recevables, y compris ceux émanant de climato-sceptiques.
Cette démarche « d’expertise collective » adoptée par le GIEC en est la marque et, j’en suis convaincu, en garantit la qualité. La dernière étape est celle de l’approbation du rapport. Le résumé pour décideurs est également sujet à commentaires, étape à l’issue de laquelle un texte est proposé à approbation ligne à ligne devant l’assemblée plénière. Même s’il s’agit là de représentants des gouvernements, le rapport reste l’entière propriété des scientifiques du GIEC, car toute modification proposée doit s’appuyer sur une conclusion déjà inscrite dans le rapport principal. Résultat, le contenu du résumé n’est que marginalement modifié comme en témoigne la comparaison du rapport mis sur table par les scientifiques et celui effectivement adopté. J’adhère pleinement à ce processus d’approbation qui se traduit par une appropriation du rapport par les gouvernements. Une adoption au sens plein du terme qui fait que ces mêmes gouvernements s’appuient sur le diagnostic du GIEC lors des négociations conduites au sein de la Convention Climat. Et qui je crois contribue à la visibilité dont ont, depuis plus de 20 ans, joui les rapports successifs.
Une question récurrente : l’Homme est-il responsable ?
Les rapports du GIEC attachent beaucoup d’importance au traitement de l’incertitude en indiquant la confiance dans la validité d’un résultat (faible, moyenne, élevée) et en lui associant un degré de probabilité lorsque c’est possible (quasiment certain entre 99 et 100 %, très probable entre 90 et 100 %, probable entre 66 et 100 %…). Mais les observations qui se sont enrichies au fil des rapports font aussi été de deux certitudes :
- L’augmentation de l'effet de serre liée aux activités humaines, mise en avant dès 1990, est très bien documentée par type de composé, par secteur économique et par pays. Ainsi, 37,5 milliards de tonnes de CO2 dont 88 % liés à notre utilisation de combustibles fossiles ont été émises en 2011, ce composé ayant contribué pour 76 % aux émissions totales de gaz à effet de serre, loin devant le CH4 (16 %), le N2O (6 %) et les composés chlorofluorocarbonés (2%).
- Le réchauffement climatique est désormais sans équivoque ; il affecte l’atmosphère mais aussi les la cryosphère (neige, glaces, glaciers et sols gelés) et l’océan, comme en témoigne l’élévation du niveau de la mer. C’est important car l’atmosphère n’utilise que 1 % de la chaleur supplémentaire liée à l’augmentation de l’effet de serre, 93 % le sont par l’océan, 3 % par la cryosphère et 3 % par les surfaces continentales. Ce réchauffement est également sans précédent depuis 1400 ans, les 30 dernières années constituant probablement la période de 30 ans la plus chaude qu’ait connu l’hémisphère Nord sur cette période.
À l'évidence, ces deux certitudes ne sont pas suffisantes pour établir une relation de cause à effet entre activités humaines et réchauffement climatique.
Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que des variations de l'ordre de celles observées au cours du XXe siècle - d’environ 1 °C – sont documentées au cours du dernier millénaire, tout au moins à l'échelle régionale. Comment dans ce contexte, a-t-il été possible d'établir que les activités humaines sont bel et bien à l'origine du réchauffement des dernières décennies ? Les scientifiques du GIEC ont placé cette question, qui leur est posée de façon récurrente, au cœur de leur diagnostic. La réponse a évolué au fil des rapports successifs. En 1990, les experts avouent leur incapacité à trancher « l'importance du réchauffement observé est grossièrement cohérente avec les prédictions des modèles climatiques mais elle est aussi comparable à la variabilité naturelle du climat ». Cette absence de diagnostic est gommée lors du second rapport qui reste néanmoins extrêmement prudent et conclut, « qu'un faisceau d'éléments suggère une influence perceptible de l'Homme sur le climat global ».
En 2001, les arguments deviennent plus convaincants et le rapport met en avant que « des preuves plus récentes et plus concluantes permettent de dire que la majeure partie du réchauffement observé au cours des 50 dernières années est due aux activités humaines ». Ce diagnostic s'est clairement renforcé en 2007, le GIEC concluant que très probablement, soit avec plus de 9 chances sur 10, l'essentiel du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle est déjà lié aux activités humaines. Le diagnostic est encore mieux établi en 2013 : il est extrêmement probable (plus de 95 chances sur 100) que l’influence de l’Homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle.
Cette conclusion doit beaucoup aux modélisateurs du climat qui ont réalisé deux types de simulations couvrant le XXe siècle. Les premières ne prennent en compte que l’évolution des forçages naturels, variabilité solaire et volcans, tandis que les secondes incluent également les forçages anthropiques, gaz à effet de serre et aérosols. Il est impossible de reproduire le réchauffement observé depuis les années 1970 si l’on ne prend pas en compte l’évolution des gaz à effet de serre, ce qui implique que nous sommes, de façon quasi certaine, dans un monde dont nous modifions le climat. Le 5e rapport va plus loin en chiffrant la contribution naturelle sur cette période à moins de 0,1 °C tandis que celle liée aux activités humaines est estimée à 0,7 °C et est donc de l’ordre du réchauffement observé. Et en concluant que l’influence humaine est également détectée dans le réchauffement de l’océan, dans les changements du cycle global de l’eau, dans le recul des neiges et des glaces et dans la modification de certains extrêmes climatiques.
Du prix Nobel à la remise en cause du GIEC
En 2007, le prix Nobel de la Paix est attribué au GIEC conjointement avec Al Gore. Les jurés du Nobel ont probablement souhaité reconnaître que la lutte contre le réchauffement climatique pouvait être un facteur de paix dans la mesure où tous les pays de la Planète sont concernés et, qu’à l’inverse, le laisser faire avec le cortège de conséquences négatives qui y seraient associées, rendrait difficile un développement harmonieux de nos civilisations ; c’est du moins la façon dont je l’interprète.
Ce prix reconnaît avant tout la qualité du 4e rapport du GIEC qui, juste avant la conférence de Copenhague, va cependant faire l’objet d’une campagne visant à le discréditer. Elle commence par le climategate, publication d'une série de courriels piratés sur le site de chercheurs anglais de l'Université d'East Anglia, se renforce par la révélation d'erreurs et se poursuit, en France et dans d'autres pays, à travers la publication d'ouvrages empreints de climato-scepticisme.
Je n'épiloguerai pas sur le « climategate » dont un des enseignements est d'illustrer, à travers des échanges d'ailleurs assez rudes, la saine divergence d'opinions qui peut exister entre climatologues. Les courriels, mal interprétés, pouvaient suggérer que des données avaient été falsifiées pour aller dans le sens des rapports du GIEC. Ils ne parlaient en réalité que de corrections sur des données, faites dans les règles de l’art, et qui ne modifiaient en rien les conclusions de leurs travaux de recherche. Il fallut une enquête parlementaire pour disculper les chercheurs de la grave accusation de fraude qui planait sur eux. D’autres enquêtes indépendantes parvenaient à la même conclusion. Malheureusement, elles n’ont pas eu le même écho médiatique que le vol de courriels qui en était à l’origine.
Les « erreurs » du GIEC sont extrêmement regrettables et à mettre à son débit. Elles apparaissent cependant marginales. Il n'y en fait qu'une erreur avérée.
Elle concerne l'assertion selon laquelle les glaciers himalayens devraient perdre 80 % de leur surface en 2035, voire plus tôt. Simple coquille (2035 pourrait avoir pris la place de 2350) ou liée à l'utilisation de littérature « grise » n'ayant pas fait l'objet de revue par les pairs, l'origine de cette erreur, reconnue par le GIEC, n'a pas été complètement élucidée. Elle ne constitue en aucun cas un point clé des conclusions d'un rapport de près de 3.000 pages. S'y ajoute une absence d'esprit critique dans la reprise par le GIEC d'une erreur faite dans un rapport du gouvernement des Pays-Bas. Corrigée ultérieurement, elle indiquait que 55 % de ce pays se situe sous le niveau de la mer. Le chiffre correct est de 26 % auxquels il faut ajouter 29 % qui risquent d'être affectés par les inondations. Il aurait donc fallu indiquer que, pour 55 % du territoire, il y a des risques d'inondation. Quant aux autres erreurs soi-disant identifiées (baisse des récoltes en Afrique, surestimation du coût des désastres climatiques, réponse de la forêt amazonienne au réchauffement climatique), elles relèvent d'une volonté de remise en cause de certaines conclusions à laquelle des réponses claires ont été apportées.
Au-delà de ces « erreurs », le fonctionnement même du GIEC a pu être remis en cause. Dans ce contexte, il est intéressant de noter la mise sur pied d'un audit externe portant sur le fonctionnement du GIEC et les différentes procédures qui ont été suivies. Assuré par le Conseil inter-académique, il s’est conclu par un verdict très positif sur les processus d’évaluation du GIEC dont néanmoins certaines mesures, notamment un renforcement de la gouvernance et de la communication, pourraient améliorer le fonctionnement. Celles-ci ont été progressivement mises en oeuvre lors de la rédaction du cinquième rapport. Même si certaines conclusions en sont discutées, ce qui est tout à fait normal, celui-ci n’a pas, à ce jour, fait l’objet d’attaques aussi virulentes et malveillantes que le rapport paru en 2007.
Les conséquences de l’inaction
Si rien n’est fait pour maîtriser l’augmentation de l’effet de serre liée aux activités humaines, nous irons à la fin de ce siècle vers un réchauffement moyen supérieur à 4 °C par rapport à l’ère pré-industrielle qui se poursuivrait au-delà de 2100. Il sera difficile de faire face à ses conséquences : récifs coralliens mis à mal, acidification de l’océan, élévation du niveau de la mer, intensification des événements météorologiques extrêmes et irréversibilité des phénomènes liés à la diminution du volume des calottes glaciaires observée au Groenland depuis une vingtaine d’années et qui commence en Antarctique de l’Ouest. Sans oublier la fonte tout aussi préoccupante du permafrost de l’Arctique et la libération de gaz à effet de serre (CH4 et CO2) qui y sera associée.
Les impacts du réchauffement toucheraient tout autant l’Homme. L’accès à l’eau serait rendu plus difficile dans certaines régions affectées par des sécheresses et des canicules à répétition. La perte de biodiversité, déjà bien réelle, serait exacerbée, certains écosystèmes naturels étant incapables de s’adapter à un changement aussi rapide. Les rendements agricoles auraient tendance à stagner, rendant encore plus délicat l’objectif de nourrir notre humanité marquée par une expansion démographique importante au moins d’ici à 2050. La pollution urbaine pourrait devenir plus difficile à supporter dans les mégapoles et ces conditions climatiques très différentes de celles d’aujourd’hui auraient également des conséquences sur la santé des populations mais aussi des animaux, sauvages ou domestiques.
Bien entendu, ces impacts ne sont pas également répartis, certains pays en voie de développement étant parmi les plus vulnérables. Mais notre pays serait également affecté comme en témoigne le récent rapport sur « Le climat de la France au XXIe siècle » : canicules et sécheresses estivales plus intenses qu’aujourd’hui seraient au rendez-vous dans le sud-est du pays, tandis que la façade atlantique connaîtrait plus de précipitations hivernales. Dans le cas d’un réchauffement de 4 °C, tous les voyants sont au rouge. L’adaptation à ces conditions climatiques serait très difficile voire impossible et, en tout état de cause, extrêmement coûteuse. Or c’est la trajectoire sur laquelle s’est inscrit notre développement depuis les années 1960. L’effet de serre n’a jamais augmenté aussi rapidement que depuis le début du XXIe siècle, en premier lieu à cause de notre utilisation croissante de combustibles fossiles actuellement à l’origine d’environ les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre.
Objectif 2 °C : un véritable défi pour nos sociétés
L’adaptation apparaît beaucoup plus accessible dans le cas d’un scénario peu émetteur qui répond à l’objectif de la convention climat à laquelle tous les pays ont adhéré et qui sera au cœur de la conférence de Paris en décembre 2015 : celui d’un réchauffement qui à long terme n’excède pas 2 °C par rapport au climat pré-industriel (soit ~ 1.5 °C par rapport aux conditions actuelles). Cette adaptation sera néanmoins indispensable car ce climat sera significativement différent de celui dans lequel nous vivons aujourd’hui. Et, en tout état de cause, le niveau de la mer continuera à s’élever de 30 à 40 cm d’ici la fin du siècle, plus par la suite.
Aujourd’hui et dans les prochaines décennies, il est vital de modifier en profondeur notre mode de développement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
L’objectif 2 °C requiert que nous émettions dorénavant moins de 1.000 milliards de tonnes de CO2. Au rythme de 2013, nous atteindrions cette valeur dans moins de trente ans. Selon les estimations des réserves présentées dans le 5e rapport du GIEC, cela implique de laisser, là où elles sont et à jamais, plus de 80 % des combustibles fossiles accessibles (pétrole, gaz naturel, charbon, gaz et pétrole non conventionnels), valeur qui ne tient cependant pas compte des combustibles qui pourraient faire l’objet d’un piégéage et stockage du CO2 émis. Les économistes du GIEC parviennent à une conclusion analogue : les scénarios compatibles avec l’objectif 2 °C correspondent à une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70 % à horizon 2050 (par rapport à 2010). Cette diminution doit de plus se poursuivre au-delà jusqu’à atteindre la neutralité carbone, voire mieux, d’ici la fin du siècle. Nul besoin d’être devin pour en déduire que recherche et innovation seront au cœur de ce développement sobre en carbone. D’après le GIEC, la part des énergies bas carbone – renouvelables, nucléaire, fossiles associées à un piégeage et stockage du CO2 – sera multipliée par 3 ou 4 à l’horizon 2050.
L’efficacité énergétique et les économies d’énergie devront être au rendez-vous dans tous les domaines : utilisations domestiques, industrie, transport, bâtiments, urbanisme, sans oublier les pratiques agricoles dont les gaz à effet de serre associés sont aussi en quantité non négligeable. Ceci conduira à repenser la façon dont nos sociétés fonctionnent individuellement et collectivement. Ce « nouveau » monde devrait se construire très largement autour de la notion de partage, de solidarité et d’économie de fonctionnalité. Le dernier rapport du GIEC conclut que cette transition vers une société « sobre en carbone » est techniquement possible et économiquement viable mais il y a urgence. Si rien n’était entrepris, d’ici 2020, pour infléchir l’augmentation des émissions, respecter l’objectif 2 °C ne serait plus envisageable.
La mission « d’expertise collective » qui, depuis sa création, est celle du GIEC va se poursuivre avec un 6e rapport du GIEC. Comme les précédents, il s’appuiera sur trois groupes de travail, structure qui permet de couvrir l’ensemble des aspects liés à l’influence des activités humaines sur le climat. De son côté, la communauté intéressée à la préservation de la biodiversité a mis en place une expertise qui s’est inspirée de l’approche suivie par le GIEC.
Même s’il nous faut constater qu’il y a un fossé entre le diagnostic de la communauté des climatologues et la mise en œuvre d’actions efficaces de lutte contre le réchauffement climatique, j’ai le sentiment que les rapports successifs du GIEC ont permis aux négociations conduites dans le cadre de la Convention Climat de s’appuyer sur un socle commun et bien établi de connaissances. Je suis fier et heureux d’avoir pu y contribuer.